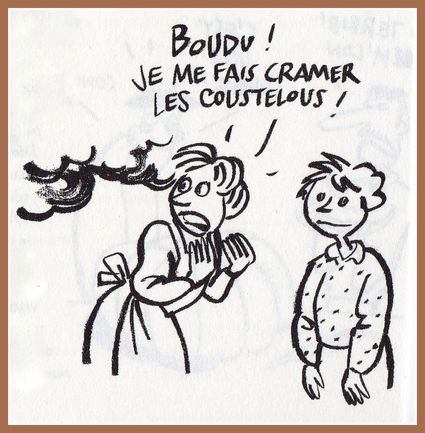A B I S T O D E N A S :
Le Français du Sud-Ouest
Bernard Vavassori
Service gratuit simple et accessible à tous
colorier - cuvier
- 10 px
- 12 px
- 14 px
- 16 px
- 18 px
- 20 px
- 24 px
- 28 px
- 32 px
- 42 px
- 48 px
- 56 px
- 62 px
- 68 px
- 74 px
- 82 px
- 90 px
- 100 px
- 110 px
- 120 px
- Background
- Text
- Arial
- Arial Black
- Book Antiqua
- Comic Sans MS
- Courier New
- Georgia
- Helvetica
- Impact
- Tahoma
- Times New Roman
- Trebuchet MS
- Verdana
- ⥢
- Ξ
- ⥤
- 𝄙
- 10 px
- 12 px
- 14 px
- 16 px
- 18 px
- 20 px
- 24 px
- 28 px
- 32 px
- 42 px
- 48 px
- 56 px
- 62 px
- 68 px
- 74 px
- 82 px
- 90 px
- 100 px
- 110 px
- 120 px
- Background
- Text
- Arial
- Arial Black
- Book Antiqua
- Comic Sans MS
- Courier New
- Georgia
- Helvetica
- Impact
- Tahoma
- Times New Roman
- Trebuchet MS
- Verdana
- ⥢
- Ξ
- ⥤
- 𝄙
colorier
v. Colorier. Aux trois premières personnes et à la troisième du pluriel du présent de l'indicatif ou du subjonctif, ce verbe est souvent prononcé [colòrieu], soit accentué sur l'avant-dernière syllabe. - Comment on le colòrieu ça, Madame ? Cette façon de parler est en voie d'extinction. (Même manière de prononcer pour copier : - Je còpieu...).
comac
adv. (argot). Ø1. Comme ça Ø2. Génial, super. - Elle est comac la nana de Raymond ! (De l'occ. coma aquò).
combien-t-il en faut ?
Un t s'intercalle intempestivement entre les deux premiers mots sous l'influence probable de "combien en faut-il".
commander
expr. Sans te (vous) commander : s’il vous plaît... - Sans vous commander, vous pourriez me faire passer une chaise, monsieur ? : (De l'occ. sens vos comandar [pron. Séns bous coumandà]).
comme ça
Dans des expressions comme : - Il me faudrait un tournevis ou comme ça pour soulever cette plaque : ... ou quelque chose comme ça. - Pour aller à Tarbes, il doit me falloir deux heures, ou comme ça. ... ou à peu près. (De l'occ. coma aquò qui s'emploie avec ces mêmes nuances de sens. Aussi en occ. quicòm atal).
comme tout
loc. adv. Très, vraiment - Ce petit, il est mignon comme tout. : ... Il est vraiment (très) mignon. - Aujourd'hui, j'ai pris un manteau !... et il a fait chaud comme tout ; on sait jamais comment s'habiller, tê ! : Cette expression entendue ailleurs en France est particulièrement fréquente "par chez nous".
commission
n.f. Faire la grosse commission, la petite commission : euphémismes pour déféquer, uriner. - Je suis embêté, j'ai besoin d'aller aux toilettes et je ne sais pas où aller. - C'est pour la grosse commission ou la petite, parce que si c'est pour la petite tu peux aller derrière l'arbre, là. Personne ne te verra ! Expression non exclusivement méridionale.
commune
n.f. Mairie. (De l'occ. comuna : maison commune). Les ouvriers de la commune : les ouvriers municipaux.
comporte
n.f. Cuve de bois servant au transport de la vendange. - Quelques jours avant la vendange on met les comportes à tremper. On les couvre avec des sacs de jute que l'on arrose régulièrement afin de faire gonfler le bois et le rendre étanche. (De l'occ. compòrta [pron. compòrto]. Ce mot occitan figure dans le larousse. Voir à, asaiguer, barquet, bécat, bigos, bourre, Bourrou, cabeçal, carredjadou, fessou, gabel, majunquer, pichobi.
comprenette, comprenelle
n.f. Cerveau, intelligence, capacité à comprendre. - Ne sois pas trop exigeante avec lui, tu sais, il est un peu dur de la comprenette. (A partir du verbe occ. comprene : comprendre). Voir banaste, idnjaourit, innocent, pépiòt, pirol
con !
interj. Marque l’admiration, l’étonnement. Ponctue la conversation, n’a pas de traduction exacte, peut être omis ou remplacé par son voisin de palier "couillon". Est naturellement absent en temps que virgule en fr. du nord de la Garonne. - Alors, con, quand je l’ai vu, j’ai pas hésité, con, j’y suis été ! ... - Oh, con ! - Bou (ou bo) du con !, - Putain con ! - Eh oh con ! Le Toulousain pur et dur qui essaie avec peine de se corriger dira seulement bouduc..., en attendant de faire mieux... En tout cas il faut noter que son emploi est de moins en moins fréquent chez les jeunes et considéré maintenant comme très peu élégant, alors qu'il passait "presque" inaperçu il y a quelques années, con ! esp. ¡coño! cat. cony !
confesser
v. 1. Se confesser. - Et la maman, où elle est ? Elle est allée promener ? - Que non ! Elle est allée confesser, que demain c’est Pâques... : (En occ. confessar [pron. counfessà]). Voir extrêmoncier, madonne, ritou Ø2. Confesser un lit : le faire à la va-vite, sans avoir aéré les draps. Ø3. expr. Ne pas être confessé de frais : se dit à quelqu'un qui vous a marché sur les pieds ; ça vous a fait mal car il a pesé de tout le poids… de ses péchés. - Eh bé ! Ca se voit que tu n'es pas confessé de frais !
connaître
v. 1. Reconnaître - J’ai vu le Roger, celui de Tuzaguét ; je l’avais pas vu depuis longtemps ; eh bé tu sais que j’ai failli ne pas le connaître ? 2. expr. Se faire connaître. - Si tu vas voir le maire, fais-toi connaître : … dis qui tu es, en précisant que tu connais des gens bien placés. (De l'occ. connéisser [pron. counèissé] : connaître et reconnaître). 3. expr. Ça se connaît que… On voit bien que…- Tu as de petits yeux ! Ça se connaît que tu t’es couché tard ! Ø4. - Je suis été au coiffeur hier, eh bé avé le vent qu'il fait, c'est pas de connaître, pauvre !… Aussi - Ça ne se connaît pas. - Je viens de balayer, mais avé ces drôles, ça se connaît pas ! : … ça ne se voit pas. Ø5. - Se connaître : - Au moment de mourir, il ne s'est pas connu : … il n'était pas conscient.
conque
n.f. Ø1. Bassine, cuvette pour laver le linge, petit bac à lessive. (De l'occ. conca). Ø2. expr. Avoir de la conque : avoir de la chance.
contenir
v. Tenir. - Catche avec les pieds parce que sinon cette vendange elle va pas y contenir dans la cuve ! : ... elle ne va pas y tenir. - Si vous venez à cinq, on va jamais y contenir dans cette voiture ! ... il n'y aura pas assez de place pour tous. Par contre on pourrait dire que cette voiture ne pourrait pas nous contenir, mais aucun méridional ne parlerait naturellement ainsi.
contour
n.m. Virage, tournant. - Pour monter dans l'Aveyron c'est surtout long à cause des contours... pasque la route elle est pas si mauvaise que ça ! Voir tournée.
contournière
n.f. Labour en bout de champ dont les sillons sont perpendiculaires aux sillons initiaux. - On aura fini de labourer le champ à midi. Comme ça, cet après-midi, il ne restera plus qu’à faire les contournières. (De l'occ. contorniera [pron. contournièro] : partie d’un champ qu’une charrue ne peut pas atteindre).
contraire (au)
loc. 1. - Pas du tout ! - Tu t’es fait mal ? (à quelqu’un qui est tombé) - Au contraire ! (De l'occ. al contrari). Ø2. au sens contraire : à l'envers - Tu pourrais travailler comme il faut, au lieu de ça, tu mascagnes et tu fais tout au sens contraire ! (De l'occ. al sens contrari).
contrefaire (se)
v. pr. - Faire un faux mouvement. - J’ai un de ces mals de dos ! - Et qu’est-ce qu’il t’arrive ? - Eh bé, je me suis contrefaite en fermant les contrevents ! - Oh ! Mince ! Voir avoir.
copain, copine (être)
expr. 1. - J’en ai marre de toi, je m’en vais ! - Pourquoi ? tu m’es plus copine ? - Non je te suis plus copine : ... tu n’es plus ma copine ? (langage des enfants, plutôt chez les filles). Aussi : - Je te tiens plus copine : Je ne suis plus ta copine. toulouse.
coque
n.f. 1. Gâteau. - Pour les Rois il est habituel d'acheter une coque, une fouace, un tourteau... suivant la région d'où l'on est. (De l'occ. còca [pron. coúco] : pain blanc, gâteau). - Aquel voldria la còca emai l'ardit ! : Celui-là, il voudrait le beurre et l'argent du beurre. cat. coca : tourte, tourteau, pâté en croûte. Voir fouace, limoux, royaume, tourteau. Ø2. Coque de maïs : épi (De l'occ. coca : épi de maïs). Voir carouille, coucarel, despélouquer, escapiter, escarouiller, millas, panouille, péloc, tanoc.
coquelin-coqueline
n. m. et f. Poule naine. L'équipe féminine de rugby de Marciac (Gers) se nomme les Coquelines. - Pour bien faire il vaudrait mieux que ce soient des poulardes que des poules naines, mais pour des filles, les coquelines c'est quand même plus joli ! …Voir caquinet, quéquét, quiquine.
coquin de sort
expr. - Oh ! Coquin de sort, alors ! J’ai le gosse qui m’est encore revenu de l’école en sang. Il n’arrête pas de se battre ! (Expr. occ. [pron. couquín dé sòrt']). Voir canaille, couqui.
corner
v. Sortir les cornes (escargots). - Il pleut, les escargots vont corner !
côté
loc. adv. 1. À côté de : Par rapport à, en comparaison avec. - Tu te plains qu'il pleut trop, eh bé, à côté de la Bretagne, il faut pas se plaindre !… par rapport à la Bretagne. Ø2. Par côté : sur le côté - "Mets-toi par côté que tu vas te faire écraser" : Écarte-toi.
coucarel, coucaril
n.m. Rafle, épi de maïs dépouillé de ses grains. Les coucarels, on s'en servait pour allumer le feu dans les poêles ou les cheminées, autrefois; et les élèves qui étaient chargés d'allumer le poêle de l'école en apportaient de chez eux. (De l'occ. cocarèl [pron. coucarèl]). NB. cat. cucurell : sommet. Voir cabosse, carouille, coque, despélouquer, escapiter, escarouiller, millas, panouille, péloc, tanoc.
coucou
n.m. Mot enfantin : œuf. Voir cocoye.
coucougne
n.f. - Ce petit il faudrait tout le temps être en train de le câliner, il adore les coucougnes (ou la coucougne)... Voir coucougner.
coucougner, coucouner, coucounéjer
v. Dorloter, se faire dorloter ; faire des câlins... - Il a dix ans, mais le soir, il aime bien aller coucougner avec sa maman. (De l'occ. coconar [pron. coucounà] : dorloter). ital. coccolare : dorloter. NB. : La ressemblance de ce mot avec l’anglais cocooning [de cocoon (cocon)], d’adoption récente, est le fruit du hasard.
coucougnette
n.f. Confiserie béarnaise (Pau) : coucougnette d'Henri IV. La Gourmandise ou "Coucougnette" fait allusion à la galanterie légendaire d'Henri IV qui aurait eu pas moins de 54 maîtresses. Elle est fabriquée à base d'amandes broyées (l'amande est considérée depuis l'antiquité comme le fruit de l'amour). Le coeur de la "gourmandise" est une amande douce entière, grillée parfumée avec un zeste d'eau de vie de gingembre et une rasade d'armagnac puis enrobée de chocolat noir. Elle est roulée entièrement à la main et trempée dans du jus de framboise qui lui donne une couleur rosée. Afin de conserver sa saveur, son moelleux et sa fraîcheur, elle est enveloppée d'un léger voile de sucre de canne Candy à la parisienne.
coucoulou
expr. Se mettre à coucoulou : s'accroupir. – Allez ! On va jouer à saute-mouton. Mets-toi à coucoulou. (De l'occ. a cocolons [pron. a coucoulous]). ital. starsene coccoloni et accoccolarsi : s’accroupir.
coucounerie
n.f. Bêtise, stupidité, connerie dont on n'ose pas dire le nom. - A la télé maintenant y a de ces coucouneries style la Starac et compagnie, y en a pour pleurer ! (Mot formé à partir de coucounét).
coucounét
n. Gros ou petit bêta. - Tu sais qu'elle est quand même coucounette cette boulangère, eh ! Elle m'a laissé une baguette alors que je voulais deux flûtes ! (De l'occ. cocomét). Voir banaste, cabourd, couèc, clouque, cocoye, couillon, estimbourlé, falourd, indjaourit, innocent, inténerc, maché, pec, pépiòt, piroulét, tartagnole.
coucourde, cougourde, coucourle.
n.f. 1. Girolle, coulemelle, cèpe et même oronge, suivant les villages. Mais en général il s'agit de champignons de peu d'intérêt. (De l'occ. cocorla [pron. coucoúrlo]). Voir moussalou. Ø2. n.f. Idiote. - Quelle coucourde cette épicière ! Elle m’a refilé un camembert au lieu d'un cabécou ! - Quelle couge (courge) celle-là ! - Coucourde, que tu es ! (occ. cogorda ou cogorla [pron. cougoúrdo-lo] : citrouille, courge). LANGUEDOC. Voir clouque, cuge, couille.
coucut, cocut
n.m. 1. Jonquille sauvage. - Ah non ! Tu confonds ! Ça, c’est pas des jonquilles, c’est des cocuts ! 2. - Coucou (oiseau) cat. cucut esp. cuco ital. cuculo coucou. Ø3 expr. - Ce gosse, il ne fait rien à l’école ! Je ne sais pas ce que je vais en faire, tê ! Lui qui voulait être fonctionnaire ! - Oh ! pauvre, tu sais bien que les agasses ne font pas des cocuts ! - (… les pies ne font pas de coucous ce qui signifie qu'avec les parents qu'il a on n'a pas grand chose à espérer de lui). On trouve aussi dans ce sens : Il ne faut pas demander des poires à un peuplier. NB. Le quartier toulousain des Trois-Cocus est bien celui des trois coucous et non des trois maris trompés. Il est en effet peu probable que, vu le nombre de couples vivant dans le coin ce soit celui des trois cocus (seulement). (De l’occ. cocut : coucou ; primevère, narcisse des prés). 4. Echenilloir (sécateur monté sur un long manche, muni d'un cordon permettant de couper les branches hautes de certains arbres). 5. merde de cocu : Gomme des cerisiers. - Il faut que j’enlève la voiture de dessous les cerisiers, qu’après elle sera pleine de merde de cocu et ça t’esquinte la carrosserie, ça, nom d’une pipe ! (De l'occ. merda de cocut).
coudénat
n.m. Andouillette - Si tu demandes du coudénat au boucher à Paris, il se pourrait qu’il ne te comprenne pas ! - Y a des chances ! (De l'occ. codena [pron. coudèno] : couenne). ital. cotenna cat. cotna : couenne.
coudène
Voir couenne
coudier
n.m. Etui pour la pierre à aiguiser. - Le faucheur met sa pierre à aiguiser dans le coudier rempli d'eau. Celui-ci peut être en bois ou fabriqué à partir d’une corne de vache évidée. Le paysan porte son coudier à la ceinture. (De l'occ. codièr [pron. coudié]). Voir daille, piquer.
coudinou
n.m. Ramequin, petit pot. - Tiens, aide-lui à préparer le dessert : mets la crème dans les coudinous. Ça ira plus vite. Voir cassette, couquelle, coufidou, oule, toupi.
coudougnat
n.m. Raisiné, confiture que l'on fait à la fin des vendanges avec du jus de raisin et d'autres fruits de saison tels que poires, pommes ou coings. (De l'occ. codonhat : cotignac). ital. cotogna : coing.
couéjer
Voir couétéjer.
couenne, coudène
n.f. 1. Couenne, peau : - Être rasé ras la coudène : être rasé de frais. 2. expr. En avoir ras la couenne : en avoir ras la casquette, ras le bol : - J'en ai ras la couenne moi de toi, eh ! Si tu continues je te fous à la Garonne ! 2. adj. Idiot, niais - Quelle couenne tu es, alors, mais tu comprends rien, ma parole ! (occ. codena). Voir coufle
couétéjer
v. 1. Remuer la queue. - Regarde comme il est content ce chien de me voir ! Il couétèje comme un pèc ! (De l'occ. coetejar [pron. couétedjà]). cat. cuejar, cuetejar. Ø2. Être responsable d’une queue de voitures sur la route : - Va plus vite, sinon tu vas couétéjer ! : ... tu vas occasionner un bouchon.
couette
n.f. 1. - Petite queue, couette (de cheveux. Figure au larousse sous ce sens) (De l'occ. coeta [pron. couèto] : petite queue). Ø2. - Couverture de plumes, couette. Prononcé kwate, notamment en gasc. cat. cueta.
couffe
n.f. 1. Gaffe, bévue... - Si tu as dit à ma femme que tu m’avais vu en ville avé la voisine, là, tu as fait une couffe, pasque moi je lui ai dit que j'allais aux cèpes ! (De l'occ. cofar : coiffer, duper). 2. Pet. (De l'occ. cofla : gonflement du ventre). Voir béchie, louf, loufe.
coufidou
n.m. Espèce de petit chaudron de fonte où l’on fait cuire, mijoter ou coufir un met. - Bon ! J’ai mis les châtaignes dans le coufidou en attendant le dessert. Comme ça elles auront le temps de se faire. (De l'occ. confidor [pron. counfidou], lui même de confir). Voir cassette, couquelle, coudinou, oule, toupi.
coufir
v. - Cuire lentement, mijoter. Les châtaignes, on peut aussi les faire coufir sous la cendre. (De l'occ. confir [pron. coufí]). Voir cramer, rabastiner, rabiner, rumer.
coufle
expr. Ø1. Être coufle : être repu ou ivre. (Variante entendue en Dordogne : avoir les pieds jufles, pour les pieds gonflés). Voir bandé, béouét, cufelle, empaffé, empéguer, fatigué, hart, hartère, joli, pété, pinté, tenir. Ø2. Être au bord des larmes. (De l'occ. estre confle [pron. estre coufle]). Ø3. En avoir un coufle : en avoir par dessus la tête. Syn. de en avoir un sadoul et en avoir ras la couenne. Voir jufle.
coufler
v. Ø1. Gonfler. Voir enfle. Ø2. Se coufler : se vanter : - Arrête de te coufler que tu vas exploser ! (De l'occ. coflar : gonfler). Voir engaillouster.
couflette
n.f. Vantard. - Quelle couflette celui-là, toujours à se faire mousser ! (De l'occ. coflar : gonfler)
couge
n.f. - 1. Courge. - Pas terrible ce melon... c'est une couge ! 2.Ø Femme idiote. (De l'occ. coja [pron. coújo] : citrouille). midi toulousain. Voir clouque, cuge, cugie, couille, coucourde. Parallèlement on note qu’en ital. on dit cetriolo (concombre, cornichon) à une personne idiote. Les cucurbitacées on donc mauvaise presse dans certaines langues latines !
cougnagne
n.m. & f. Couillonou, benet, niais. Voir banaste, cocoye, couillon, counét, counifle, cunèfle, fada, inténerc, pec, pépiòt, pirol.
couille
n.f. 1. Conne. - Ne l’écoute pas, c’est une couille et pas autre chose ! Féminin de con, mais beaucoup plus vulgaire. Voir clouque, coucourde, cuge. Ø2. expr. Avoir les yeux en couilles d'hirondelle. Voir yeux.
couillofe
adj. Sot, nigaud, imbécile (De l'occ. colhaud). Voir coucounét, couillonét
couillon
n.adj. 1. Sot, nigaud, benêt. Injure sans méchanceté. - C’est un brave couillon ! : c’est un bel idiot. Figure au larousse comme mot fr. (En occ. colhon [pron. couillou] : testicule) 2.- Eh bé couillon ! Exprime l’étonnement, l’admiration... Peut également servir de ponctuation comme son proche parent con. Voir con. ital. : coglione : testicule, poltron, personne stupide. cat. collóns : couilles. Es un imbecil de collons : c'est un bougre de couillon. esp. cojón, cojones : testicule-s - employé à toutes les sauces, sans avoir le sens de stupide.
couillonner
v. - Tromper, escroquer... - Le mécano, il m’a bien couillonné. Il m'a changé les freins de la voiture alors que je lui avais demandé de me regarder les plaquettes rien que ! Figure au Larousse comme mot fr. Faire quelque chose à la « m’as couillounat quand t’ai bist » (En occ. M’as colhonat quand t’ai vist): n'importe comment. Littéralement "tu m’as couillonné dès que je t’ai vu". Voir enfler, enganer. De l’occ. colhonar [pron. couillounà].
couillonou, couillonét
n.m. Petit couillon ou gros bêta, au choix. Insulte gentille qui ne doit jamais être vexante. - Couillonou, va, que tu es ! (De l'occ. colhonon, colhonét).... Voir couillon.
couilloule
n.f. Folle avoine. (De l'occ. coguola). cat. cugula.
couillounas
n.m. Grand couillon. (De l'occ. colhonàs). Voir couillon.
couler
v. Soutirer, passer, filtrer le vin. - Il va être temps de couler le vin nouveau ! (De l'occ. colar [pron. coulà]). cat. colar, esp., colar, ital. colare, même sens. Voir alambiqueur, barral, barricou, Bourrou, farlabique, gabel, pintou, riquiqui.
counas, counart
n.m. Grand con. Con suivi du suffixe augmentatif occitan - às. Voir banaste, cabourd, couillon, counét, counifle, cunèfle, pépiòt et aussi despindjolard, fégnantas, ficelle, fier, galé, grandas, grandét.
counét
n.m. Petit con, niais, personne peu futée. Voir connaud.
counifle, cunèfle, counét
n.m. Con. Si un counas est un vrai con et un grand con à la fois, un counifle ou un cunèfle ainsi qu'un counét sont des petits cons ou des pauvres cons, en tout cas des gens pas très dégourdis. Voir banaste, cabourd, couèc, clouque, cocye, couillon, estimbourlé, falourd, indjaourit, innocent, inténerc, maché, pec, pépiòt, piroulét, tartagnole.
coup
n.m. Ø1. expr. Passer un coup : - Passe-toi un coup par la figure que tu es tout sale. - Il faut que je passe un coup par terre ; tu as sali avé tes souliers plein de boue ! : sous-entendu un coup de gant de toilette ou de serpillière. Ø2. d'un coup de… - Bernard ! Va chercher le pain, d'un coup de voiture ! : Signifie en voiture, mais également rapidement. On dit aussi : d'un coup de vélo et même d'un coup de pied, c'est à dire à pied, mais vite. Voir bomber, blinde, bringue, brúllos, fum.
couper
v. 1. Casser. - Tu sais pas que son fils il s’est coupé le bras en descendant les escaliers ? - Eh bêêêê !... Remarque, il vaut mieux ça, que de se couper une jambe ! - Tu l’as dit ! - Tu as encore coupé un carreau, eh ? - Ouh ! A moi, les mots croisés, ça me coupe la tête ! Ø2. - Abîmer - Arrête de jouer avec ce stylo, tu vas finir par le couper ! (De l'occ. copar [pron. coupà] : couper, tailler, casser, interrompre). Voir catuillier, escagasser, escaraougner, péter, pigner, trucher. 3. couper l’eau : expr. Si en fr. standard on coupe l’eau avec un robinet, dans le Sud on peut aussi la couper en y mettant un peu de vin, afin qu’elle soit plus agréable à boire ! Cependant que dans le "Nord " on coupe le vin avec un peu d’eau, ici c’est le contraire, c’est l’eau que l’on préfère couper. Il ne faudrait pas qu’elle fasse mal, à trop en boire !
coupét, coupéti
n.m. Nuque. - Tâche moyen de m'écouter, parce que sinon tu vas en prendre une sur le coupét, que tu vas comprendre ! Le t de coupét est sonore. (De l'occ. copet). ital. coppa.
couquelle
n.f. Ø1. Marmite de terre. (de l'occ. coquèla : casserole - mais en métal-, cocotte). Ø2. Poitrine. - Et comment ça se fait qu'il respire à mal aise, eh ? Il est malade de la couquelle ou quoi ? (de l'occ. coquèla : figuré : poitrine). Voir barbe, estomac, gargamelle, papatch, poumpil, poupous.
couqui de Diou, (de sort)
expr. - Mais ferme-la cette porte, une bonne fois, couqui de Diou (couqui de sort) ! (Expr. occ. littéralement : coquin de Dieu (de sort). cat. coquí : coquin. Voir coquin, Dieu, diou bibant.
courbagne
n.f. Marcotte, provin, sarment de vigne que l'on couche en terre pour en obtenir une nouvelle souche et que l'on sépare ensuite lorsqu'il ou elle est raciné(e). (De l'occ. corbanha ou corbada). Voir asaiguer, barquet, bécat, bigos, bourre, Bourrou, cabeçal, carredjadou, comporte, courréjade, fessou, gabel, majunquer.
courinaïre
n.m. Coureur (…de femmes mais pas forcément. Se dit de celui qui est toujours par monts et par vaux, en affaires, en balade ou en voyage). Voir courinère. (Mot occ. corrinaire).
courinère
n.f. Ø1. Envie de courir, de voyager, d'aller faire les magasins. expr. Avoir la courinère. Ø2. n.m.et f. Celui ou celle qui aime courir, voyager... ... (De l'occ. corrinaire). Voir galopère.
courniole
n.f. Gorge, œsophage. (De l'occ. corniòla).
courréjade
n.f. Sarment de vigne que l'on attache au fil après la taille. Voir pichobi. Voir aussi asaiguer, barquet, bécat, bigos, bourre, Bourrou, cabeçal, carredjadou, comporte, courbagne, fessou, gabel, majunquer. (De l'occ. correjada).
coursaïre
n.m. Adepte actif de la course landaise. (De l'occ. corsa : course).
coustelous
n.m. Morceaux de côtes de porc. - Ah ! Les coustelous à la braise ! Ça c’est quelque chose, eh ! (De l'occ. costelons [pron. coustélous]). Voir carbonade, croustelous, pelade.
cout
n.f. Pierre à aiguiser, queue à faux (que l'on mettait dans le coudier, étui à pierre, que le faucheur portait à la ceinture). (De l'occ. cot [pron cout]).
coutelle
n.f. Grand couteau de cuisine ou de boucherie. (De l'occ. cotèla [pron. coutèlo]).
couti !
interj. – La fermière appelle les poussins en criant couti, couti ! Voir péti.
coutibe
n.f. Champignon commun, oreillette ou pleurote du panicaut. (Aude : de l'occ. cotiva [pron. coutíbo]).
coutinou
n.m. Poussin. Pour appeler les poussins on dit péti péti !, piou piou ! ou coutinou, coutinou ! (De l'occ. cotin : poussin). "Coutinou, píou píou toutjour bíou (En occ. cotinon, pio pio totjorn viu : poussin, piou piou, toujours en vie), se dit à propos des personnes souffreteuses se plaignant constamment de leur santé, qui cependant vivent longtemps et enterrent les costauds.
couvé
expr. Œuf couvé : Œuf couvi, gâté pour avoir été couvé ou gardé trop longtemps - Au lycée les salles de chimie sentaient régulièrement le dioxyde de soufre. On disait que cela sentait les œufs couvés. (De l'occ. uòu coat, ou coadís [pron. ouòou couat', ou couadis]). cat. ou covat. Voir clouque, glousse.
cramer
v. Brûler. 1. - Tu crois pas que ça goût à cramé ? : ... un goût de brûlé. 2. - Si tu sais pas quoi faire de l’huile cramée, tu la portes au mécano. Lui, il s’en sert pour se chauffer. - ... l’huile de vidange. (De l’occ. cramat. - se dit en France hors Occitanie. Figure au larousse). cat. cremat esp. quemado : brûlé.
craspét, craspec
adj. Crasseux - Lave-toi un peu s'il te plait avant de prendre la voiture... pasque, craspét comme tu es, tu vas me salir tous les sièges. cat. cras esp. craso. Voir cagagnous, pourcas.
craoumel
n.m. Cage grillagée portative pour isoler ou protéger certaines volailles (De l'occ. craumèl ou cremèl ou même cremèla : cage à poules ou à poussins)
crébadis, crébadou
n.m. Éreintement - Décharger des camions toute la journée au marché-gare, c’est un véritable crébadis ! (De l'occ. crebadís : sujet à crever). Voir aganit, escaner, gagner, hart, hartère, mascagner.
crébère
n.f. Crève, surtout à la suite d’un coup de froid. - Je ne vais pas aller travailler demain ; je te tiens une de ces crébères, que je dois avoir au moins quarante huit de fièvre ! (De l'occ. crebar : crever). Voir agacis, foutu, lancer, mal (avoir du), patchaque, pét de travers, pierre (souffrir les), poutingue, requinquiller, tras.
crémail
expr. - Couper le crémail : faire quelque chose d'extraordinaire. - Il a eu le permis au premier coup ? Eh bé alors ? Y en a pour couper le crémail :… Il n'y a pas de quoi en faire un plat. (Du gasc. cremalh ou carmalh: crémaillère).
crème
n.f. Énergumène, zigomar. - Ces deux, ce sont des crèmes de première ! Jamais où il faut, jamais quand il faut, toujours en train d'en faire une ! (NB. : en argot fr. la crème est ce qu'il y a de meilleur, l'élite ; ici c'est le contraire).
crémère
n.f. Cage d'osier ou de grillage où l'on met la glousse. Les poussins étant libres d'aller et venir alors que celle-ci en est prisonnière. (De l'occ. cremera). Voir banaste, caoujole, carredjadou, garbuste, paillassou, panière.
crever la faim
loc. Crever de faim. - Il dépense tout son argent avec les femmes et après il crève la faim ! (Influence de l’occ. crèbafam [pron. crèbofam] et du fr. crève-la-faim).
crier
v. 1. Gronder. - Moi, je m’en vais puisque tu arrêtes pas de me crier ! (occ. cridar). Expr. pas pour crier. 2.- Paul ! Il y avait du roulage vers Montpellier ? – Oh non ! Pas pour crier... pas exagérément. ital : gridare, sgridare : gronder.
criquer
v. tr. Ecraser un insecte, puce notamment, entre ses ongles. (de l'occ. cricar : écraser).
crogne
n.f. Égratignure ; bosse, bleu - Arrête de faire la capuchette, tu vas te faire une crogne. (Du gasc. cronha : meurtrissure). Voir bougne, pélat, pét.
croire
v. Ø1. Souvent prononcé croivent au lieu de croient à la 3° personne du pluriel. - Je leur ai dit que demain on travaillait pas, eh bé il me croivent pas ! Ø2. Être prétentieux. - Regarde-le, lui. Il se croit, là..., il fait son malin ! Aussi : il s’en croit. esp. ser un creído : être un prétentieux. 3. expr. T’as qu’à croire ! : ... compte là dessus ! - C’est pas grave, le prof il ne nous dira rien si on ne lui rend pas le devoir aujourd’hui ! - Ouais ! T’as qu’à croire ! 4. - Eh bé tu peux croire ! Expression marquant l'étonnement, la déception ou la colère. Voir rappelle-toi ! (De l'occ. podes créser !).
croix
expr. Une croix devant un mort : - Je m’en vais mettre une ficelle sur le passage, comme ça les gens ne passeront pas ! - Ouais alors là, ça, ça va faire comme une croix devant un mort ! : ... être totalement inefficace. (De l'occ. I fa coma una crotz davant un mòrt).
croque-sel (à)
expr. A croque-sel : à la croque-au-sel - Aujourd'hui on va manger des tomates à croque-sel, comme ça on n'aura pas besoin de cuisiner, tê !
crousel
n.m. Tas de gerbes. (occ. crosèl). Voir gerbière, plounjou.
croustade
n.f. Tourte. (Tourte de pigeonneaux, de poulets, de foies de canard, de fruits de mer). Espèce de pâtisserie à base de pâte brisée ou feuilletée, que l'on remplit de pommes, il s'agit alors de la croustade aux pommes. (De l'occ. crostada).Ital. crostata.
croustade
n.f. Tarte - La croustade est une tarte généralement aux pommes. (De l'occ. crostada [pron. croustàdo] : tourte). Voir andesse, échaudé, pompe, pastis, oreillettes, farinettes
croustelous
n.m. Côtelettes de porc. (De l'occ. amalgame de crostilhons et costelons). Voir coustelous et croustillous.
croustét
n.m. 1. Quignon, croûton - Quand on était gosse, nous autres à goûter, on mangeait juste un peu d’ail frotté sur un croustrét. Et rien plus ! C’était la guerre, pauvre ! Ø2. Casse-croûte. - Si tu viens à la palombière avé nous, amène-toi le croustét, eh ! (De l'occ. crostét [pron. croustét]). cat. crostó ; ital. crostone. Ø3. Croûte d'une plaie. - T'as vu le croustét que j'ai par la jambe ? - Eh bé, ne te le fais pas sauter qu'après t'auras une marque ! (De l'occ. crostièr). cat. crostís.
croustillous
n.m. Côtelettes de porc. (De l'occ. crostilhons). Voir croustelous et coustelous.
cruchade
n.f. Galette de maïs que l'on fait cuire sur les braises ou, mieux, dans de la graisse de cochon. Aussi : espèce de polenta de maïs au beurre, qui se mange en général avec une viande en sauce, du confit ou un salmis de palombe. (Du gasc. cruishada). Voir armottes, millas, pastét.
crusague
n.f. Russule, "Champignon à lames, à chapeau jaune, vert, rouge ou brun violacé. On trouve les russules en été et en automne dans les bois ; certaines sont comestibles [russule charbonnière], d'autres toxiques" nous dit le larousse. (Du gasc. crusaga). Voir moussalou.
crusques
n.f.pl. Ce qui a été rongé, ce qui reste d’un repas. - Tu arrives un peu tard pour casser la croûte ! On t’a laissé que les crusques ! (De l'occ. cruscar : croquer). esp. cuscurro : croûton de pain.
cuente
n.m. Problème. Un millecuentes est une personne qui accumule les problèmes. (origine incertaine).
cufe
adj. Se dit des légumes : creux. - Ces radis, ils sont tous cufes ! (De l'occ. cuf). Voir cufi, cuflé.
cufelle
n.f. 1. Peau de châtaigne. (De l'occ. culefa ou cufela, gousse ; chose sans valeur). Ø2. Cuite. - Ramasser ou se tenir une cufelle : être ivre. Voir bandé, béouét, coufle, empaffer, empéguer, fatigué, hart, hartère, joli (se mettre), pété, pinté, sadoul, tenir (en ~ une). Ø3. Avare. - Tu sais que celui-ci c'est une cufelle, eh ! Il a des oursins pleins les poches !
cufi
adj. ou p.p. Fatigué, fourbu, épuisé. - Eh bé, je suis content d'avoir fini le déménagement, mais je suis cufi ! (De l'occ. cuf : creux, vide).
cuflé
adj. Fauché, ruiné. GERS. (De l’occ. cuf, creux, vide).
cufler
v. Battre à plate coûture, plumer. Après une piquette à un jeu on peut entendre : - On les a cuflés ! (De l'occ. cufar : mettre quelqu'un à sec). Voir Fanny.
cuge
Voir couge, cugie.
cugie
n.f. Fille ou femme stupide. (De l'occ. coja [pron. coújo] : citrouille). Voir clouque, cuge, couge, couille, coucourde.
cugner
v. Coincer, se serrer dans un coin. - Et pourquoi tu restes cugné sur la chaise, tu fais le mourre ou quoi ? (De l'occ. cunhar).
çui-là
Voir celui-là.
cuiller, queuiller
n.m. Prononcé [queuillé] comme dans le verbe cueillir. Féminin en fr. mais au masculin en occ. - J’ai la serviette, le couteau, la fourchette, mais pas le queuiller ! Il me manque toujours quelque chose ! (De l'occ. lo culhièr).
cuillère, queuillère
n.f. [pron. queuillère]. - C’est comme ça qu’on met la table ? Il manque la moitié des queuillères. Va les chercher, vite ! (Influence du verbe cueillir).
cuillerée
Prononcé [cu-yeuré]. - Tu en reveux de la soupe, Marcel ? - Oh, une cuyeurée, si tu veux... De l'occ. culhierada pron [cuyeràdo]). Voir cuiller, cuillère, cuillette.
cuillette
n.f. Petite cuillère, cuillère à café.
cuissotte
n.f. Grosse cuisse de bébé ou d'enfant. (De l'occ. cueissòta). Voir cuissou.
cuissou
n.m. Ø1. Petite cuisse potelée de bébé ou d'enfant. Ø2. Bébé potelé que l'on va prendre dans ses bras. (De l'occ. cueisson). Voir cuissotte, langou, momo, nono, pépês, pissou, pòt, poutou, quiquette.
cuit
expr. Être mal cuit : n'être pas dans son assiette. - Ouh là là ! Le pitchou il est mal cuit ce matin !
cul
loc. Être de cul, tomber de cul : … sur le cul - Quand il va entendre ça, il va en tomber de cul ! (occ. de cuol). esp. caer de culo. Proverbe local : Qui veut vivre longtemps, à son cul donne du vent ! (occ. Qual vol viure longament, a son cuol dona de vent !).
culard
adj. Chanceux. (Du fr. avoir du cul : de la chance).
cule
n.f. Tronc d'arbre, souche. - J'ai trouvé quelques champignons, tê, autour d'une cule vieille là-bas… (De l'occ. cula [pron. cùlo]). Voir souc.
culèfe
Voir cufèle.
culéjer
v.intr. Remuer le postérieur sur un siège, ne pas rester en place. - Mange et tiens-toi bien au lieu de culéjer sans arrêt ! (De l'occ. culejar : remuer la croupe ; ruer ; rouler le derrière en marchant, se trémousser). cat. culejar.
culottes
n.f. Culotte. Les culottes vont la plupart du temps par paires. Au pluriel dans le Midi, au singulier en fr.. - Je te mets une paire de culottes de plus dans la valise, et tu te les changeras tous les jours, eh ! / - Quand il commence à raconter ses histoires, il y a de quoi se pisser aux culottes, tu sais ! (…de rire , bien sûr). (Ce pluriel vient de l'occ. cauças ou bragas, eux aussi au pluriel, alors que ces mots désignent un objet singulier... mais destiné à couvrir deux fesses ou deux jambes). ital. mutande, braghe, les deux au pluriel. esp. bragas, braguitas, calzoncillos, les trois au pluriel. cat. bragues, au pluriel également. Voir braguer, pantalons.
cundale
Voir candale.
cunèfle
n.m. et f. Crétin, idiot, imbécile. - Ça ne m'étonne pas de lui, ce cunèfle... il sait même pas ce qu'il raconte ! (Mot fabriqué avec cun- qui rappelle cul et con auquel on a rajouté un suffixe sonore et occitan -èfle). Voir counifle…
cuque
n.f. Ø1. Insecte. Laid comme une cuque. : vraiment très laid. - Faire la cuque : faire la tête. Ø2. Flemme. - Quelle cuque que je me tiens aujourd'hui ! Ø3. Vieille voiture. - J’ai toujours ma vieille cuque. Tant qu’elle marche, je la garde ! (NB. : une cuque est toujours vieille). (De l'occ. cuca : lente, chenille, petit insecte). cat. cuca : bestiole, esp. cuca : chenille, cucaracha : cafard. Voir mourre.
cuquét
n.m. 1. Larve de phrygane (perce-bois). Excellent pour la pêche à la truite. Ø2. adj. laid, mal fichu, petite cuque. Voir cuque.
cure-oreille
n.m. Forficule, perce-oreille - Bou du, c'est dégoûtant ! J’ai trouvé plein de cure-oreilles dans le raisin ! (De l'occ. curaurelha [pron. curaourèillo]). cat. papaorelles.
curer
expr. Curer le rec. Se dit d'une voiture qui est allé au fossé. - Tê y en a un qui a curé le rec, y devait te tenir une mounine, çui-là ! (De l'occ. rec : ruisseau, rigole, ruisseau de rue, fossé entre les champs, sillon pour évacuer les eaux). cat. rec. esp. regar, ital. irrigare : arroser. Voir bartassière.
cure-toupi, cure-toupine
n.m. Parisien ou tout autre citadin originaire de la campagne, revenant au pays. (m. à m.: qui cure le toupi, soit la marmite. Se dit de celui qui ne veut rien laisser perdre des bonnes choses de son pays et qu'il ne retrouve plus à la ville). Voir doryphore et toupi.
curoníou
n.m. Le dernier de la couvée, le cadet, le dernier d'une famille nombreuse. - Tu es fils unique toi, non ? - Mais qu'est ce que tu racontes ? Je suis le dernier d'une famille de neuf ! - Ah ! mais tu es le curoníou alors ? (De l'occ. cura nid : celui qui "cure le nid", qui "s'emporte" tout ce qui reste). Voir catchaniou, caganis.
curpiton
n.m. Croupion de volaille. Voir currou, troufignous.
currou
n.m. Croupion d’une volaille, sot-l'y-laisse - J'ai de la chance il n'ya que moi qui aime le currou ici ! (De l'occ. curron [pron. currou]). Voir curpiton, troufignous.
cusque
Voir crusque.
cussarrat
n.m. Faire un cussarat. (m. à m. faire un cul serré) ; fermer le trou d'un sac en serrant le tissu ou la toile avec une ficelle et obtenir quelque chose qui a l'air d'un "cul serré" (De l'occ. cuol sarrat).
cussonné
adj. Mangé par les vers du bois. - Le buffet que tu as acheté aux puces, c’est pas une affaire... Il est bien joli, mais il est tout cussonné ! (De l'occ. cussonat ; cusson [pron. cussou] : insecte xylophage, cusson, vrillette, charançon)
cussou
adj. 1. Insecte xylophage, cusson, vrillette, charançon 2. Avare, radin - Ce n’est pas la peine que je lui demande de me prêter 1 euro à lui... Il est tellement cussou qu'il me dira qu'il a laissé le porte-monnaie à la maison ! Ø3. Expr. Avoir le cussou : Être très fatigué (comme rongé de l'intérieur par un insecte). (De l'occ. cusson [pron. cussou]). fr. : cossus, esp. coso. Voir acheter, argent, arracou, plaindre, rapias, sou, tant vendanger.
cutou
n.m. Petite sieste. Je m'en vais faire un cutou, tê, avant d'aller me promener... Voir siestou.
cuvier
n.m. Bassin, généralement en ciment, qui servait autrefois à faire la lessive. Peu commode car particulièrement lourd, on l'installait une fois pour toutes près d'un robinet ou une descente d'eau. Voir bugade, lessif, ruscade.
E
eau
1. expr. - Ce grand feignant, il se gagne même pas l'eau qu'il boit ! De l'OCC. Se ganha pas l'aiga que beu. … il est donc vraiment très fainéant ! 2. Eau douce : eau potable. (De l'OCC. aiga doça).
échabousit
adj. Abasourdi ; assommé ; étonné ; étourdi ; niais ; mal réveillé. Voir estabousit.
échapper
v. Laisser tomber, lâcher. - Au supermarché figure-toi que j'ai échappé deux bouteilles d'huile, qu'elles ont explosé et que j'en ai mis partout ! J'étais génééée ! / Au rugby, vu la forme de la balle, il est facile de l'échapper ! Il faut donc faire bougrement attention d'éviter le faire ! (Ce mot fait partie du vocabulaire que les Méridionaux qui l'emploient sont per-suadés d'utiliser à bon escient lorsqu'ils parlent français. En FR. d'oïl on s'échappe, on laisse échapper une bouteille ou une balle ; une bouteille ou une balle peuvent nous échapper des mains, mais on n'échappe rien… Ça ne vous aura pas échappé. Cette construction parti-culière au Midi vient de L'OCC. escapar qui est à la fois transitif et intransitif).
échaudé
n.m. Petit pain à l’anis. - Si tu vas à Rignac, ramène-moi quelque échaudé. Il s'agit d'une pâte d'anis, pliée en triangle et jetée dans de l'eau chaude (De l'OCC. escaudat [pron. es-caoudàt]). A l'origine mélange de son et d’eau chaude donnant une pâte pour alimenter les volailles, puis grillée. A Carmaux (Tarn) la biscuiterie qui les confectionne en détient le brevet de fabrication depuis plus de cent ans. Il existe trois tailles d'échaudé : l'échaudé gros, le charlot (de taille moyenne), dur à l'extérieur et tendre à l'intérieur, mais dur tout court dès le lendemain… et le jeannot, petit triangle croustillant. Une variante de dégus-tation de l'échaudé consiste à le laisser tremper et gonfler dans du vin, rouge ou blanc, toute une nuit. On peut ou non le sucrer suivant ses préférences. On dit que les mineurs carmausins utilisaient ce procédé afin d'emporter plus de vin au fond de la mine.
échelles
n.f.pl. Escaliers, coups de ciseaux maladroits laissant apparaître une "échelle" dans la coupe des cheveux. - Qui c'est qui t'a coupé les cheveux ?... Que tu as plein d'échelles dans le cou !
échorder
v. Assourdir. - Un pet de fusil à côté des oreilles, con, ça m'a échordé ! (Du GASC. eshordar).
échourouiller (s')
v. S'écrouler, s'effondrer.
écoles
n.f. École supérieure, université. - Oh ! Tu sais que çui-là il en sait des choses. - Mais c'est que, couillon, il a été aux écoles ! - Aaaah bon, c'est ça !
écouter
v. Obéir. - Si tu vas chez Papy, tu l'écouteras, eh, sinon il te voudra plus chez lui ! Tu as compris ? (De l'OCC. escotar [pron. escoutà] : écouter, obéir).
éfan Voir fan
égal (c'est)
expr. Tout de même. -Eh bé, c'est égal, eh, je pensais pas qu'il allait mourir si vite ! Aussi : Ça fait rien ! : même sens.
eh ?
interj. Hein ? , pardon ?- Tu entends ce que je te dis ? - Eeeeh ? - Je te demande si tu entends ce que je dis ? - Eh bé, ne crie pas si fort, je suis pas sourd, quand même, macaniche !
eh bé !
interj. Eh bien !... - Eh bé ! tu viens ou tu viens pas ? /- Eh bé tê, maintenant on est dans de beaux draps ! / - Eh bé, c'est bien ! : Seul un méridional peut s'exclamer ainsi, car en fran-çais d'Oïl cela donnerait "Eh bien, c'est bien !" / - On va se faire un pastaga, tê ! - Eh bé ! (… allez, pourquoi pas !) Aussi, en rencontrant quelqu'un et en guise de salut : - Eh bé ? (Alors ? Qu'est-ce que tu deviens ?) (De l'OCC. e ben). Certaines phrases hésitantes peuvent être exagérément chargées de eh bé.
eh oh !
interj. 1. Oui ! 2. Eh bien dis-donc !, - Je viens de faire 30 km en 10 minutes ! - Eh oh ! Tu bombes, toi ! (exprime l’étonnement ou l’admiration). (De l'OCC. òc : oui).
élabàci
Voir délabaci, délaouatz
élastic
n.m. élastique. Curieusement, alors que les muettes finales sont clairement prononcées dans le Sud-Ouest, on prononce élastic et non élastique. Voir moustic, plastic.
embarras
expr. Se sortir des embarras - Mais sors-toi des embarras, nom de nom si tu ne fais rien ! Tu ne vois pas que tu gênes ! Débarrasse le plancher ! Voir plier (se), pouchíou.
embartasser (s')
v. Se mettre dans le fossé (dans la haie) avec une voiture. - Cette voiture, méfie-t-en, elle est bartassière comme tout. Avec, tu t'embartasses comme qui rigole ! (De l'OCC. bartàs : haie de ronces). Voir bartassière.
embâtardir
v. Abâtardir. - Ces bêtes elles s'embâtardissent à force de s'accoupler entre elles. Il faut que j'en achète de nouvelles. - Et ton chien c'est pas un vrai, il est embâtardi aussi ! (De l'OCC. embastardir).
embaucher
v. - Commencer la journée de travail. A quelle heure tu embauches toi, demain ? Opposé à débaucher : NB. : en FR. embaucher quelqu'un signifie l'engager. Voir débaucher.
emborgner
v. Eborgner. - Fais attention avec ce bâton, tu risques d’emborgner quelqu’un ! (OCC. embor-niar). CAT. emborniar.
emboucaner
v. 1. Fumer : Emboucaner une viande. 2. Une pipe emboucanée : une pipe culottée. 3. Littéralement puer le bouc. - Ouvre un peu les fenêtres que ça emboucane ici ! (De l'OCC. embocanar [pron. imboucanà] de boc : bouc). Voir arraquer, enfaléner.
embouféné
part. pass. & adj. Bouffi ; enflé - Hier on a eu le banquet de la pétanque. Eh bé aujourd'hui j'ai la tête emboufénée ! …. la tête lourde. (De l'OCC. embofir : bouffir).
embreïcher
v.tr. Ensorceler (Du CAT. embruixar) ESP. embrujar. Voir camecruse.
embudéler
v. Mettre la viande dans les boyaux (saucisse, saucisson). - Quand on embudèle la saucisse, il faut faire attention de pas trouer les boyaux, sinon ça dégueule. (De l'OCC. budel : boyau, intestin, tripe). ITAL. budello, CAT. budell. : boyau.
embuféquer
v. Fâcher, se mettre en colère. (De l'OCC. embufecar).
embuquer
v. Donner à manger avec un entonnoir, gaver (embuc). - Tu peux pas manger tout seul, à ton âge ! Tu veux pas que je t’embuque, non plus ! (De l'OCC. embucar [pron.imbucà] : gaver). CAT. embussar, ESP. embocar, embuchar, ITAL. imboccare. Entonnoir : CAT. embut, ESP. embudo.
embusquer
v. 1. Voler, arnaquer. – Combien tu m'as dit ? 1 ou 2 euros le café ? – Ah ! Toi ! Commence pas à m'embusquer de bon matin, eh ! Voir estamper. 2. Entraîner. - C’est elle qui m’a embusqué dans cette combine ! 3. Emporter, embarquer. Je ne retrouve plus mon C.D. C’est encore toi qui me l’a embusqué ! - ARGOT MER. (De l'OCC. emboscar [pron. imbouscà] : cacher dans un bois). ITAL. imboscare, CAT. & ESP. emboscar : embusquer au sens militaire.
emcambouner
v. Entraver. - Si tu montes au grenier, fais attention de ne pas t'encambouner, parce que avec toutes les vieilleries qu'il ya partout, ça pourrait bien t'arriver. (De l'OCC. encambonar, placer un anneau au genou d'un animal pour l'empêcher de courir, lui-même de camba : jambe).
emmascarer
v. Barbouiller, salir. - Alors déjà qu'on est en retard, lui il trouve rien de mieux que d'arriver emmascaré de chocolat pour nous faire gagner du temps ! Tu sais que eeeeeh ! (De l'OCC. mascar : masquer). ESP. enmascarar, ITAL. mascherare : masquer.
emmasquer
v. Ensorceler. - Mais putain ! Je suis emmasqué aujourd'hui ou quoi ? Il m'arrive que des tuiles ? (De l'OCC. emmascar). Voir masque.
émoun
n.m. Tas, grande quantité. - Je viens de ramasser le linge, j'ai un émoun de serviettes à ran-ger, tê ! (De l'OCC. mont : tas, mont, montagne). ESP. montón, ITAL. montone. Voir pilòt.
empaffer
v. Saouler, empiffrer. - Je crois que j'en ai trop bu de ton cahors ! Je suis un peu empaffé ! (De l'OCC. empafar [pron. impafà], empiffrer). Voir bandé, béouét, coufle, cufelle, empéguer, fatigué, joli, pété, pinté, tenir (en tenir ~).
empatafé
part. pass. Crétin, couillon, bêta. (Probablement de l'OCC. patufèl, même sens).
empatufaïre
n.m. Celui qui porte la poisse. - Je suis embêtée de partir avec cet empatufaïre, parce que tu vas voir qu'il va encore nous arriver quelque chose avec la chance qu'on a nous autres ! (Ori-gine incertaine).
empatufer
v. Porter la poisse. (Origine incertaine).
empègue
n.f. Bleu, horion, ecchymose. - A force de me faire empéguer je suis couvert d'empègues ! (De l'OCC. empegar [pron. impegà] : poisser, empêtrer...). Voir empéguer, désempéguer.
empéguer
v. 1. Coller, poisser 2. Cogner - Ouille ! Je viens de m' empéguer une chaise ! Je me suis tordu le pied ! 3. Être ivre - Le Julien il t'a pris une murge, con, il est à peine un peu empé-gué : ce qui signifie qu'il en a pris un coup ! (De l'OCC. empegar [pron. impegà] : poisser, empêtrer...). CAT. & ESP. empegar : poisser. Voir bandé, béouét, coufle, cufelle, empaffé, fati-gué, joli, pété, pinté, tenir.
empétégué
p.p. et adj. 1. Empêtré. - Je me suis empétégué cette ficelle là, j'arrive pas à la défaire. 2. - Enrhumé, pris. - Mais, tu tousses ! - Tais-toi ! Je suis complètement empétégué. 3. Empétré dans les ennuis. - Mon pauvre mari, il est empétégué dans ses affaires avec son héritage, il ne dort plus, pauvre ! (De l'OCC. empedegar ou empetegar [pron. impedegà] : empêcher, embarrasser). Voir assadouler, cagagne, ergne, gníco-gnáco, hartère, mouscaille, mafre, peine (porter).
emplâtre
n.m. - 1. Gifle - Je te lui ai foutu un emplâtre, crois-moi, il a compris qu’il fallait me parler sur un autre ton ! (De l'OCC. emplastre : soufflet). Voir birotélaï, bouffe, bourmal, mournifle, rébirebaïtén, rebiromarioun, rouste. 2. Empoté - Remue-toi un peu ! Espèce d’emplâtre ! ARGOT MER.
en
prép. 1. Dans l'expr. - Je n'en peux rien : Je n'y peux rien (Claque OCC. de N'en podi pas rès). 2. En, devant les noms de fermes ex.: En Peyrét : Frédéric Mistral dit qu'il faut voir là l'aphérèse du titre honorifique Monsen que l'on employait autrefois devant le nom propre (par ex. Monsen Peyrét – en FR. Monseigneur Pierre Petit – serait devenu En Peyrét). Il indique la dégradation linguistique suivante : monsegne, monsen, monsen, sen, en. (d'après Simin Palay).
encoquer
v. Cogner (se dit surtout pour un véhicule). - Je me suis fait encoquer la voiture dans le par-king du supermarché. Le mec, il m'a pas laissé son adresse ! (De l'OCC. en + còca + ar : cogner sur la coquille). voir bougner, pigner.
encore
adv. - Et encore tu es là, toi ? Adverbe en tête : Et tu es encore là, toi. ESP., cons-truction identique, adv. en tête : ¿Todavía estás aquí, tú?
encrumer (s')
v. S'embrumer, s'obscurcir, se couvrir (en parlant du ciel). - Oyoyoy ! Ça s'encrume. Il va pleuvoir avant ce soir ! (De l'OCC. encrumir). Voir encucagné, encucaragné.
encucagné
adj. Couvert, bouché, très nuageux. - On va pas partir en montagne cet après-midi ! C'est encucaragné vilain là-bas ; ça va péter avant ce soir ! - Quel temps il fait chez vous ? - Oh ! C'est encucaragné aussi ! (De L'OCC. cuc : obscur, sombre, suivi d'un suffixe OCC. sonore). Voir s'encrumer.
encucaragné
Voir encucagné.
enfaléner
v. Puer. - Bou du con que ça enfalène ici ! Ça sent le rat enfermé ! (de l'OCC. enfalenar). Voir arraquer, emboucaner.
enfanguer
v. - Embourber. Méfie-toi de ne pas t’enfanguer en passant par là avec la voiture ! (De l'OCC. enfangar). ITAL. infangarsi, ESP. enfangarse, CAT. enfangar-se. Voir fangassière.
enfermé
part. pass. Renfermé. - Ouvre les fenêtres que ça sent l’enfermé ici ! (De l'OCC. embarrat : odeur de renfermé). NB. CAT. embarrat : enfermé, barricadé. Voir fermé.
enfin !
adv. (OCC. enfin). 1. Exprime la fatalité : C’est comme ça, on n’y peut rien. Enfin !.... Il vaut mieux que je me taise... [En baissant le ton sur l'avant-dernière syllabe], exprime la résigna-tion. 2. [Appuyant sur la dernière syllabe] exprime le désaccord, l'étonnement : - Tu ne manges pas beaucoup, toi ! - Et enfin !... tu trouves ?
enfle
adj. Enflé. - Il a trébuché en montant les escaliers ; après trois jours, il a encore le pied tout enfle. (De l'OCC. enfle). ITAL. gonfio, CAT. inflat, ESP. inflado.
enfler
v. Tromper. - J’ai voulu payer de suite, eh bé... je me suis fait enfler, tê ! (De l'OCC. enflar : enfler ; battre, rosser, souffleter). NB. CAT. inflar el cap : rompre la tête.
engaillouster (s')
v. 1. S'étouffer, s'engouer (De l'OCC. s'engalhostar). NB. CAT. engargussar-se : se mettre en travers du gosier. 2. expr. Coq engaillousté : Garçon qui fait le fier avec les filles. Voir escaner, estouféguer.
enganer
v. 1. Tromper, duper. - Se faire enganer. ESP. engañar, CAT. enganyar, ITAL. ingannare. Voir couillonner, enfler. 2. Coincer. - Je peux pas sortir la voiture du parking ; elle est complète-ment enganée, y en a un qui m’a collé devant et un autre derrière ! (de l'OCC. engana : gêne).
englander
v. 1. Ecraser, cabosser, bosseler. - Fais gaffe en descendant le talus de pas aller t'englan-der en bas sur les rochers !). 2. Assommer. (De l'OCC. englandar).
engorger, gorger
v. Gaver oies ou canards. Voir embuquer.
engranière
n.f. Balai. (De l'OCC. engraniera, lui-même de engranar : balayer le grain). CAT. agraner, granera : balai, agranar : balayer.
engraniérou
n.m. Petit balai. Voir baléjon, engranière.
enquiller
v. 1. Introduire. - Regarde si tu peux enquiller ce manche dans cette pelle ! 2. Cogner. - Tu vas m’aider à sortir cette table, mais fais attention de ne pas t'enquiller la porte en sortant ! Voir empéguer. 3. Réussir un drop ou une transformation au rugby : - Il a réussi à l'enquiller entre les deux pagelles, pourtant y avait le vent d'autan et en plus il était de biais ! 4. - J'ai gagné deux oies grasses au loto et maintenant, il va falloir que je me les enquille ! : ...que je me débrouille pour les préparer. ARGOT MER. (En OCC. enquilhar [pron. inquillià] : empiler, introduire).
ensaché, ensaqué
part. pass. Mal habillé. - Ce type-là ce n’est pas l’élégance personnifiée ! ... Il est toujours mal ensaqué ! (De l'OCC. ensacar [pron. insacà] : ensacher). CAT. ensacar et ITAL. insaccare : ensa-cher. Voir afargué, arranger, braguer, débraguer, dégaillé, dégargaillé, déjarguer, despapat-ché, despipadé, fargué, jargué, marquer, sac.
enseigner
v. Indiquer. - Vous qui connaissez tout le monde, vous ne m’enseigneriez pas un bon plombier, des fois ? (De l'OCC. ensenhar [pron. inségnà]). ESP. enseñar, CAT. ensenyar : indiquer, montrer.
ensuquer
v. Assommer - Cette nuit, je me suis couché tard et je suis un peu ensuqué. - Ce vin blanc, je crois qu’il m’a un peu ensuqué. (De l'OCC. assucar, de suc : sommet de la tête et sucar : as-sommer) NB. en ITAL. zucca : caboche, zuccone : grosse tête, entêté. Voir apapésít.
entoupiner
v. Mettre en pot ou dans tout autre récipient. - Il convient d'entoupiner la saucisse dans de la graisse pour la conserver. (De l'OCC. entopinar). Voir toupi.
entre autre
loc. - Depuis l'accident il faut j'aille chez le kiné. Mais pas tous les jours, un jour entre autre rien que , eh ! : ...un jour sur deux.
entrecuisse
n.f. Haut de la cuisse du poulet. - Tu préfères la cuisse ou l’entrecuisse ? (OCC. entrecuèissa [pron. intrécuèisso]).
entuter (s')
v. S'enfermer de manière excessive. - Je ne le vois plus ! Il est toute la journée entuté dans sa baraque, là-haut à Montloubère ! (De l'OCC. tut, tuta : tanière, repaire, caverne, la tute du grillon). Voir tuter.
envers
adv. Par rapport à, en comparaison de. Mais tu ne manges rien toi, dis donc ! Eh bé, envers ce que ton père avale! : ... par rapport à ce que... (De l'OCC. envèrs : en comparaison de).
épincettes
n.f. Pincettes. - Tiens, tant que tu as le bras tendu, ramasse ce morceau de bûche avec les épincettes !
épines
n.f. Broussailles, ronces des haies. - Faire brûler des épines : faire brûler le produit du net-toyage des haies à la campagne. (De l'OCC. espín, espina : buisson épineux ; aubépine). Voir bartas, boudias.
ergne
n.f. Humeur chagrine, inquiétude, souci, ennui. - Pourquoi tu sousques comme ça ?- Je sais pas, j'ai l'ergne. (De l'OCC. èrnha).
ergnous
adj. Être ergnous : être soucieux. (De l'OCC. ernhós).
esbérit
adj. Éveillé, alerte, sémillant, espiègle. - Rappelle-toi que ce pitchou il est esbérit quelque chose, eh ! : Il est très éveillé et quelque peu déluré. (De l'OCC. esberit). Voir abélugué.
escachalat, escachilé
part. pass. Édenté ; entamé (en parlant d'un fromage). (De l'OCC. escaçolat : entamé par les rats ; ébréché par accident). ESP. escacharrar : bousiller.
escagasser
v. Abîmer, esquinter.- Pour une fois que je lui prête le cyclo, il est allé faire du moto-cross avec et il me l’a tout escagassé, ce counas ! (OCC. escagassar : fienter avec effort ; affaisser ; écraser ; aplatir, lui-même de cagar : chier). NB.: CAT. escagassar-se : avoir la chiasse, s'affaisser. Voir catuillier, couper, escaraougner, péter, pigner, trucher.
escaliers
n.m.plur. Escalier. - Il s’est cassé la figure par les escaliers, il est tout mâché ! (Pourtant en OCC. escalièr est au sing.). A noter cependant qu’en Belgique aussi on dit "les escaliers".
escalourat, escalouré
adj. Réchauffé, -e. -Tu es bien escalourat toi ce matin. En chemise, avé le froid qu'il fait ! (De l'OCC. escalorar : réchauffer) CAT. acalorat. ESP. acalorado,
escampadou
n.m. Epanchoir de canal ou de moulin. (De l'OCC. escampador). Voir pachère, tournal.
escamper
v. 1. Jeter - Cette cafetière toute déglinguée, j’en ai marre de la voir, je m’en vais l’escamper au tertre ! (De l'OCC. escampar : répandre, verser, jeter, perdre, gâter). CAT. escampar : répandre, éparpiller. 2. Partir, filer. - Bon ! Moi j'en ai marre, je m'escampe ! 3. tomber, s'étaler. ITAL. scampare : se sauver. NB. ESP. escampar existe mais signifie cesser de pleuvoir.
escampiller
v. Répandre, éparpiller, semer. - Attention, ton sac est troué ! Regarde que tu escampilles du blé partout ! (OCC. escampilhar). CAT. escampar : répandre, éparpiller. Voir espandir, verser.
escaner (s')
v. 1. S’étrangler.- Le petitou, il a avalé une arête ! Il a failli s’escaner, pecaïre ! (OCC. se escanar). CAT. escanyar-se. ITAL. scannare : égorger. Voir estransiner. 2. Se tuer à la tâche - Je suis fatigué moi de m'escaner au boulot pendant que toi tu n'en fiches pas une rame ! Voir aganit, crébadis, gagner, hart, hartère, mascagner.
escapiter
v.t. Écimer, étêter un arbre ou une plante (maïs…). - Cette sapinette, tu devrais l'escapiter un peu, sinon elle va être plus haute que la maison, bientôt. (De l'OCC. escapitar, lui-même de cap : tête). Voir carouille, coque, coucarel, despélouquer, escarouiller, millas, panouille, péloc, tanoc.
escaragnade, escaraougnade
n.f. Réplique très vive lors d'un échange de propos. (De l'OCC. escarraunhada [pron. esca-raougnádo]: écorchure, égratignure).
escaramiqué
adj. Qui a les jambes écartées ; qui est à califourchon. - Qu'est-ce que tu fais par terre esca-ramiqué comme ça ? Tu es tombé ou tu fais le grand écart ? (Du GASC. escarramicàt). ESP. encaramado : juché sur, perché.
escaraougner
v. - Abîmer, égratigner. - C'est pas facile de parler le français ; nous autres, les gens du Midi, on a un peu tendance à escaraougner les mots. (De l'OCC. escarraunhar [pron. escaraougnà].
escardil
n.m. Rafle, épi de maïs égrené (mot occ. : escardilh).
escargolade
n.f. Voir cargolade.
escarouiller
v.t. Égrener le maïs. (Du GASC. escarrolhar : peigner le lin pour en ôter la graine). Voir ca-rouille, coque, coucarel, despélouquer, escapiter, millas, panouille, péloc, tanoc.
escarrer
v. Essuyer son assiette avec un morceau de pain de façon à la laisser propre. - Allez, chacun escarre son assiette avant le fromage. Ici on ne change pas les assiettes pour le dessert ! (De l'OCC. escarrar : racler, ratisser).
esclaffemerdes, écrase-merdes
n.f. Chaussures, parfois larges du bout. -T’aurais quand même pu acheter des chaussures un peu élégantes pour le mariage de ta sœur plutôt que ces esclaffemerdes ! (De l'OCC. esclafar : écraser).
esclaffer
v. Ecraser. - Comme un crétin, je suis allé m’esclaffer contre le platane ! Voir espoutir. (De l'OCC. esclafar : écraser. A ne pas confondre avec esclafir : s’esclaffer de rire). CAT. esclafar : écraser, écrabouiller. Voir englander, espoutir.
esclaoufit
n.m. Mauvaise odeur, odeur de renfermé. - Il faut ouvrir les fenêtres et aérer, ça sent l’esclaoufit ici ! Voir arraquer, enfaléner, emboucaner.
esclapou
n.m. 1. Éclat de bois, copeau, utilisé pour allumer le feu, 2. expr. - Maigre comme un esclapou. (De l'OCC. esclapon [pron. esclapou]). Voir chisclét, maigrichòt, réchichouét, sar-naille.
esclapouti
adj. et part. pass. Se dit d'un gâteau qui n'a pas gonflé à la cuisson ou d'un coussin écrasé. - C'est une tarte ça, ou un soufflé esclapouti ? (De l'OCC. espotir : écraser). Voir espoutir.
escoubassat, escoubassit, escoubassòt
n.m. Repas de fin de vendanges, du côté du Madiranais. - Maintenant que les vendanges sont finies, on va faire l'escoubassòt et on va se dire à l'année prochaine ! Simin Palay fait remarquer qu'en gascon, l'escoubasò signifie, notamment la conclusion, la fin d'un travail, d'une entreprise. En Lomagne, c'est le repas que l'on donne après avoir bâti une maison. (De l'OCC. escoba : balai). ESP. escobazo : coup de balai, ESP. escoba, ITAL. scopa : balai. Voir brespail, déjeuner, dîner, esprantiner, fristi, graillou, manger, mongétade, souper.
escoupit
n.m. Crachat. (De l'OCC. escopir : cracher). CAT. escopir, ESP. escupir : cracher.
escruches
n.f.pl. Restes. - Donnez-moi vos escruches, ça m'évitera de changer les assiettes pour le des-sert, tê ! (De l'OCC. cruscas). Voir crusques.
esculer (s’)
v. 1. Tomber sur le cul, à la renverse. – Redresse-moi ce sac comme il faut, sinon il va s’esculer nom de nom ! (De l'OCC. escular). CAT. escular : éculer, ITAL. sculacciare : fesser. Voir atchouler, empéguer, enquiller, espatarrer, estabanir, pastifresser. 2. Esculé : adj. et part. pass. Éculé, déformé. S'emploi en général pour des chaussures, justement éculées, dont l'arrière est quelque peu écrasé. - Tu ne peux pas aller à noce avé ces souliers complète-ment esculés! Il t'en faut une paire de neufs quand même, depuis le temps que tu les traînes ceux-là ! (De l'OCC. esculàt).
espandir
v. Répandre. - Si tu avais pris un panier pour porter ces châtaignes, tu en aurais pas espandi partout ! (De l'OCC. espandir). en CAT. expandir, ESP. esparcir, ITAL. spandere : répandre, éparpiller.
espanir
v.t. Sevrer, pour un petit veau. (De l'OCC. espanir : mettre les enfants au pain; lui-même de pan : pain). Voir bédélou, brau, répoupét, rouèc, velle.
espanter
v. Epouvanter, stupéfier, épater, époustoufler. - Quand il m’a dit le prix qu’il a payé sa BM, con !... ça m’a espanté ! Surtout qu'elle est même pas neuve ! (De l'OCC. espantar : épouvan-ter ; stupéfier...). CAT. et ESP. espantar, ITAL. spaventare : épouvanter. NB. pour stupéfier, le CAT. emploie espaterrar. Voir espatarrer, estabousir.
esparriguer, esparriquer
v.t. Eparpiller. - Un fusil qui esparrigue : qui éparpille ses plombs. (De l'OCC. esparricar : s'étaler en prenant de la place).
espatarner (s')
v. Voir s'espatarrer.
espatarrade
n.f. Chute de tout son long (De l'OCC. esparatarrada). Voir rêche.
espatarrer (s’), espatarrailler (s’), espatarraquer (s')
v. S'étendre de tout son long. – Atche-le, ton frère s’il s’en fait, tout espatarré dans l’herbe, sous le tilleul / - La première fois que je suis monté sur des skis, je me suis espatarré devant tout le monde... J’avais bonne mine, tê ! / -C'est espatarrant : c'est renversant. (De l'OCC. : espatarrar : étendre à terre, tomber de toute sa longueur ; s’épanouir de plaisir). ESP. despatarrarse. CAT. espaterrar-se : se renverser. Voir atchouler, empéguer, enquiller, esculer, estabanir, pastifresser.
espélir
v. Eclore. - Je suis contente, tê ! La clouque a fini de couver, les petits poulets ont espéli hier. (OCC. espelir). CAT. espellida (peu us.) : éclosion. Voir clouque, caoujole, coutinou, glousse, poulet.
espéloufit, espéloufrit, espeilloufrit
adj. Ébouriffé, hérissé ; effarouché, effrayé. Il est temps que le papa aille au coiffeur ! Re-garde-le là comme il est espéloufrit ! (De l'OCC. espelofir, espelhofrir). Voir espéluqué.
espéluqué
adj. Dépeigné, les cheveux en bataille. Ne me regarde pas, eh ! Que je viens de me lever et que je suis encore toute espéluquée ! (De l'OCC. espelucar : dépouiller le maïs. Un espéluqué ressemblerait donc à un épi de maïs dépouillé, avec ses peaux en éventail). ESP. (AMÉR. LAT.) espelucar, espeluzar (peu us.).
espépisser
v. Trifouiller la nourriture pour enlever ce qui déplaît (le gras du jambon notamment). - Mange au lieu d'espépisser comme ça, espèce d'estoufignous que tu es ! (De l'OCC. espepis-sar ou espepidar, espefidar, espepissonar, espepiussar : éplucher, examiner, regarder dans tous les sens, ôter les petites plumes des volailles). Voir canets, espessugner, espigouter, espiouter, tchaoupiller, tchaoupiner, trafiquer, trifougner ; estafignous, fastigous, nicous.
espère
n.f. Attente, affut. La chasse à l’espère : Le chasseur est posté dans l’attente de tirer sur le gibier. (De L’OCC. espera [pron. espèro]).
espérer
v. Attendre. - Ton frère n’est pas encore arrivé ? - Non ! Il commence à se faire espérer ! (De l'OCC. esperar). ESP. et CAT. esperar. Voir bader, ergne, inquiéter, tirer, tenir, trastéjer.
espessugner
v. 1. Éplucher, démêler avec beaucoup de soin (De l'OCC. espesir). 2. Espessugner un texte : le lire et le relire pour le comprendre et l'analyser. Voir espépisser.
espette
Voir clé.
espigouter
v. Eplucher ; trier les légumes. (De l'OCC. espigotar). Voir espiouter.
espintcher
V. tr. Lorgner, épier, observer. - Tu t’entends bien avec ton nouveau voisin ? - Pas trop ! Il est tout le temps en train d’espintcher derrière les carreaux. Ça me plaît pas trop, ça ! (De l'OCC. espinchar [pron. espintchà]).
espiouter
v. Enlever les petites plumes du poulet, mais aussi enlever les petits morceaux de gras de la viande (Quelque peu péjoratif). - Les jeunes d'aujourd'hui, ils n'aiment pas le gras et espiou-tent toute la viande parce que ça leur plaît pas ; ils laissent le meilleur, tê ! (De l'OCC. espigo-tar : ôter des débris d'épi ; éplucher, nettoyer). CAT. espigolar : glaner, butiner, grappiller. Voir canets, coque, coucarel, espépisser, espessugner, espiouter, panouille, péloc, pélufres, tanoc, trier.
espoumper
v. Faire gonfler une jupe ou une coiffure aplatie. - Avec ce foulard j'ai les cheveux complète-ment aplatis ! Il faudrait que je les espoumpe un petit peu quand même, sinon de quoi je vais avoir l'air ? (De l'OCC. espompar, espompir : gonfler).
espoutir
v. Ecraser, écrabouiller. - Quand j’ai vu l’arbre qui commençait à tomber, je me suis sorti de dessous en quatrième vitesse ! Tu m'aurais retrouvé complètement espouti, couillon ! (De l'OCC. espotir [pron. espoutí]). Voir englander, esclaffer.
esprantiner, esprandiner
1. v. Déjeuner ; dîner. 2. n.m. repas de midi ; repas du soir. (De l'OCC. esprandinar ou esprantinar). Voir brespail, crusques, déjeuner, dîner, escoubassàt, fristi, graillou, manger, mongétade, souper.
esquicher
v. 1. Coincer, serrer, presser... Pousse-toi un peu ! Tu vois pas qu’on est tout esquiché, là ! / Si tu vas au supermarché ne me mets pas les boites de petits pois sur les fraises comme la dernière fois, eh ! Que tu me les as toutes esquichées ! 2. On trouve parfois ce mot dans le sens d'écorcher (la peau) et déchirer (un vêtement) : - Mais ne pleure pas ! Tu t'es juste un peu esquichée ! On te voit pas encore le foie ! (De l'OCC. esquichar). CAT. esqueixar, ITAL. schiacciare. Voir catcher, quicher, toucher.
esquilou
n.m. Grelot. - Si tu vas danser la bourrée, n’oublie pas tes esquilous ! (De l'OCC. esquila : clo-chette). ESP. esquila, CAT. esquillerinc : grelot, clochettes.
esquinter
v. 1. Abîmer. - Je me suis esquinté le doigt avec un marteau. 2. Epuiser. - Il s’esquinte à longueur de journée dans le champ ! Jamais il se repose ! (De l'occitan esquintar). Figurant au LAROUSSE. CAT. esquinçar : déchirer.
esquipòt
n.m. Reste culinaire. - Ressers-toi ! Tu ne vas pas me laisser cet esquipòt tout de même ! (De l'OCC. esquipòt : bourse, tirelire ou aussi son contenu ; estomac ; gésier)
estabanir
v.t et intr. Tomber en faiblesse, s'évanouir. - Si tu ne manges pas plus que ça, macarel, tu vas t'estabanir ! (De l'OCC. estavanir). Voir aganit.
estabousir
v. tr. 1. Stupéfier, abasourdir, étonner ; assommer. - Quand qu’il m’a dit qu’il allait se marier avec la fille du maire, ça m’a estabousi ! Aussi : - Je suis resté complètement estabousi ! : ... stupéfait. (De l'OCC. estabosir [pron. estabousí]) CAT. estabornir, même sens. 2. Estabousi : adj. et n. Idiot. - Il vaut mieux un petit dégourdi qu'un grand estabousi. Phrase prononcée par un petit, revanchard, cherchant à s'accommoder de sa petite taille. (De l'OCC. estabosir [pron. estabousí]).
estalbier
v.t. intr. et r. Economiser, épargner. - Tu peux commencer à estalbier si tu veux partir en vacances ! (De l'OCC. estalviar). CAT. estalviar ; caixa d'estalvis : caisse d'épargne.
estamper
v. - Voler, arnaquer. Cinq euros un pastaga ! Là, je voudrais pas dire, mais tu t’es vachement fait estamper... ARGOT. (De l'ITAL. stampare, soutirer de l'argent). Figure au LAROUSSE.
estaoumassier
v. Assommer - Mais tu vas l’estaoumassier si tu continues à lui taper dessus comme ça ! (Ori-gine incertaine). Voir assuquer, clesquer, englander, estourbir.
estarrusser
v. 1. Démolir des mottes de terre en tapant dessus avec un râteau. 2. Assommer, tuer un lapin. - Pute de lapin, il m’a échappé juste au moment où j’allais l’estarusser, il m’a fallu le courser à travers le jardin ! (De l'OCC. estaussar, émotter, et terràs : motte de terre)..
estataragner, estataragnéjer, estargagner
v. Enlever les toiles d'araignées ou tataragnes (De l'OCC. aranha [pron. aràgno] : araignée et tataranha [pron. tataràgno] : toile d’araignée). Voir tataragne.
estélé
adj. et part. pass. 1. Etoilé, pour le ciel, signe de beau temps. (De l'OCC. estela : étoile). 2. Illuminé, et par extension, fêlé. - Il sort en tee-shirt l’hiver et il met des pulls au mois d’août, il est un peu estélé, lui, eh ! (De l'OCC. estelar : fendre, briser). ESP. estrellado, CAT. estellat, ITAL. stellato : étoilé.
estéringle
n.f. 1. Seringue 2. Personne maigre. - Mange un peu, espèce d'esteringle, si tu veux devenir grand et costaud comme ton père ! (De l'OCC. esteringla). Voir brèle, chisclét, grahus, menut, piètre, peine, tras.
estibade
n.f. Dans l'expression faire l'estibade : Se faire embaucher comme journalier chez les fer-miers de la région pour les moissons par exemple. (OCC. estivada [pron. estibado]). CAT. estiuada.
estimbourlé, etsimbourlé
adj. 1. Désorienté, déconcerté, déboussolé. - Depuis qu'il a perdu sa femme, ce pauvre Ernest, il est complètement estimbourlé. 2. Simple d'esprit - Celui-là, il est un peu boulégué du bulbe, il est un peu estimbourlé, même ! 3. Fou. (De l'OCC. estimborlat : écervelé, étourdi, lui-même de timbol : fou). Voir banaste, brave, cabourd, clouque, cocoye, counas, couillon, counét, counifle, cunèfle, fada, inténerc, pec, pépiòt, pirol, tartagnole, tim-boul, voyage (en tenir un).
estirgougner
v. Etirer - Eh bé ! Si tu l’estirgougnes comme ça, ce pull, tu vas en faire une robe de chambre ! (De l'OCC. estirgonhar [pron. estirgougnà] : tirailler); CAT. estirganyar, même sens. Voir bader.
estofich, estofinade
n.f. voir stockfisch.
estomac
n.m. Poitrine. - La Catinou, eh bé on peut dire qu'elle a de l'estomac. [NB. Si l'on prononce le c d'estomac, c'est encore mieux]. (De l'OCC. estomac : estomac, poitrine, sein). Voir barbe, couquelle, gargamelle, papatch, poumpil, poupous.
estomaquer
v. Ecœurer, causer du dégoût. - Mais qu'est-ce que tu t'es foutu comme parfum ? Putain, ça m'estomaque ! (De l'OCC. estomagar : couper la digestion).
estoufadis, estoufaranis
n.m. 1. Chose indigeste, difficile à avaler. - La fouace, c’est bon, mais si tu vas trop vite, c’est un véritable estoufadis ! 2. Endroit où il fait très chaud, où l'on étouffe. (De l'OCC. estofar [pron. estoufà]: étouffer).
estouféguer
v. Suffoquer ; suffoquer au point de s’asphyxier.- Ouvre un peu, il n'y a pas d'air, on s'estou-fègue. / - J'ai avalé un morceau de travers, je m'estoufègue. (De l'OCC. estofegar [pron. estoufégà]). CAT. ofegar, ESP. ahogar, ITAL. soffogare, même sens.
estoufét
n.m. Ragoût de pommes de terre et de haricots. - Tu vois le dimanche, on se fait souvent un estoufét. Après on va faire la sieste et et on s’endort sans problème ! (De l'OCC. estofet [pron.estoufét]). CAT. estofat, ESP. estofado, ITAL. stufato : viande à l'étouffée, daube.
estoufignous, estafignous
adj. Délicat, difficile pour la nourriture ; qui chipote. – Ah ! Tu ne veux pas boire à la gourde après moi ! Mais tu sais que tu es un peu estoufignouse, eh ! (De l'OCC. estofinhós [pron. estoufignoús]: dédaigneux). Voir espépisser, fastigous, nicous, tchaoupiller.
estoufobièillo
n.f. Étouffe-chrétien. Se dit d’une pâtisserie farineuse, lourde ou sèche. Mais c’est de l’estoufobièllo cette fouace ! Où t'as trouvé ça ? (De l’OCC. estofa-vièlha [pron. estoufobièil-lo] : m. à m.: étouffe-vieille). Voir estoufobougre.
estoufobougre
n.m. Sorte de pâtisserie ou galette cuite à la poêle, appelée ainsi car comme l'estoufobièillo, elle est un peu farineuse et sèche. (de l'OCC. estofar : étouffer). Voir estoufobièillo, estou-fogat.
estoufogat
n.m. Voir estoufobièllo, estoufobougre. (De l'OCC. estofa gat : m. à m. : étouffe-chat)
estourbir
v. Mot français. Assommer. - Avant de tuer le lapin, tu lui fous un pét sur la tête, tu l’ estourbis ! Après tu lui arraches un oeil et tu attends que le sang coule... Après ça, tu peux l’écorcher. Tu vois, c’est pas difficile ! Figure au LAROUSSE, mais d'un emploi plus fréquent dans le Sud de par sa consonance occitane, bien que d'origine allemande : gestorben. Voir assuquer, clesquer, englander, ensuquer, estaoumassier.
estourniquer
v. Éternuer. - Et qu'est-ce que t'as à estourniquer tout le temps, tu as pris froid ou quoi ? (De l'OCC.; estornicar). ESP. estornudar, CAT. esternudar, ITAL. starnutire.
estranger
n. Étranger. - On connaît personne ici ! Y a que des estrangers ! (De l'OCC. estrangièr [Pron. estrandger]). CAT. estranger, ESP. extranjero, ITAL. staniero.
estransiné
part. pass. et adj. Racorni, flétri, replié sur lui-même. - Et tu vas nous faire manger cette sa-lade toute estransinée ? Mais je vais aller t'en ramasser une autre moi, eh ! (De l'OCC. estransinar : se dessécher d'inquiétude).
estransiner
v. Étrangler ; égosiller. - Coupe des morceaux plus petits, nom d'un chien ! Sinon tu vas t'es-transiner ! (De l'OCC. estransinar). Voir escaner.
estrémer
v.t. Enfermer, mettre en lieu sûr, mettre de côté. (De l'OCC. estremar).
estretch
adj. Etroit. - Là, on passera pas avec le camion ! Il faut dire que c’est un peu estretch ! (De l'OCC. estrech, estreit). CAT. estret, ESP. estrecho, ITAL. stretto.
estripaïre
n.m. Cultivateur, appareil agricole attelé servant à émotter ou à gratter superficiellement le sol. - Plutôt que de labourer je préfère passer un coup d'estripaïre, ça fait aussi bien et ça va plus vite ! (De l'OCC. estripar : émotter).
estriquét
adj. Voir estretch.
estron
n.m. - 1. Etron, fiente, crotte. - Va chercher les oeufs au poulailler, mais fais attention de pas marcher dans les estrons de poules ! 2. Morveux. - Bah ! Tu n’es qu’un estron ! (De l'OCC. estront). ITAL. stronzo, même sens, (mais aussi : con, salaud, connard). Voir farnous, mécut, farnous.
estuger (s')
v. Se faufiler en essayant d'éviter les regards. - Essaye voir si tu peux pas passer devant tout le monde en t'estugeant sans que personne ne te voie ! (De l'OCC. s'estujar : s'enfermer ; se cacher).
et
conj. Dans le parler méridional, cette conjonction est intercalée dans les nombres comme 70, 75… : soixante-et-dix, soixante-et-quinze… (En FR. cette manière de dire se retrouve uniquement dans 21, 31, 41, 51, 61, 71, et non dans les nombres qui les suivent). Curieu-sement ni en FR. ni dans le parler méridional on ne dira quatre-vingt-et-un alors qu'on dit vingt-et-un !
étable
n.m. Étable (f. en FR.) - On entend encore "Le petit étable, le vieil étable"... (De l'OCC. es-table, n.m.). ESP. establo (n.m.).
étenailles
n.f. Tenailles. - Va demander les étenailles au voisin. Je sais plus qu’est ce que j’ai fait des miennes ! (De l'OCC. estenalhas). CAT. estenalles, même sens.
être
v. 1. été employé comme part. pass. d'aller. - Votre fils n'est pas là, madame Lespinasse ? - Eh bé non pauvre, il a été au coiffeur. …il est allé chez le coiffeur, mais il n'en est pas encore revenu. (Cependant en FR. on peut dire : J'ai été à Paris l'an passé (dans le sens de "j’y ai séjourné»), ou bien : - la dernière fois que j'ai été chez le coiffeur... 2. Autrefois on entendait à la campagne : - Je suis été à la foire, pour : "Je suis allé…". 3. expr.- Tu as été en ville ? ... à y être, tu aurais pu acheter le pain ! :... tant que tu y étais... ESP. he estado, ITAL. sono stato : je suis allé. 4. expr. Être de (être de bac, de noce). - Demain je ne peux pas venir, je suis de noce. Quand un professeur méridional dit : - Je suis de bac, c'est qu'il est convoqué pour surveiller ou corriger le bac. NB. : En FR. on dit bien : être de la fête. 5. être (absence du verbe). - Ma voiture ne tourne pas du tout bien, je crois qu'elle a besoin de réviser ! : ... d'être révisée. - Tu me donneras tes pantalons, qu'ils ont besoin de laver ! : ... d'être lavés. (calques OCC., y compris le pluriel de pantalon).
eu
part. pass. de avoir. - Est-ce que tu sais en quelle année est mort Louis XIV ? - Je l'ai eu su macaniche, mais je ne m'en rappelle plus... : ... je l'ai su, mais je ne m'en souviens plus... Je l'ai eu su est la première personne du singulier d'un passé surcomposé qui comporte deux participes : eu et su. Le Méridional, même s'il désire bien parler le français, aura beaucoup du mal à se défaire de cet emploi (qui n'est d'ailleurs pas fautif, mais plutôt désuet). Ce temps est un prétérit particulièrement parfait qui renvoie le plus souvent à jadis : je l'ai su, autrefois, mais, cela est sûr, je ne le sais plus du tout aujourd'hui ! /- Moi du café j'en ai eu bu jusqu'à six tasses par jour quand j'étais jeune !... et je dormais pareil ! : ... j'en ai bu, j'en buvais... (En réalité, ces expressions que l'on entend dans d'autres régions de France - comme le fameux "ça eu payé" de Fernand Raynaud -, si on ne les entend quasiment plus dans la bouche de ceux qui veulent parler français "comme il faut", on les a eu entendues, c'est à dire qu'il nous est arrivé de les entendre, autrefois.
euro, franc (les un)
Loc. L'euro, le franc - Excusez-moi, Madame... Je n'ai pas de monnaie... vous n'auriez pas les un euro par hasard ? Habitué à dire les 10 c, les 2 €... on oublie que 1 euro est naturelle-ment au singulier. NB : On dit aussi on va fêter ses un an.
exemple
loc.adv. Par exemple : Tout à fait académique cette expression figurant dans les diction-naires français est néanmoins très fréquemment employée par les personnes âgés de notre Midi qui s'exclament : - Ah ça par exemple ! Tu ne me l'avais pas racontée celle-là !
extrêmoncier
v. - Donner l'extrême-onction. - La pauvre garce, elle va pas en avoir pour longtemps ; le curé achève de l'extrêmoncier. ... Le curé vient de lui donner l'extrême-onction. (Dans le parler populaire ce sacrement est devenu l'extrêmontion, mot qui par défaut a réclamé un infini-tif). Voir ritou.
F
F.C.A., Fécéa
n.m. - Le Fécéa est le club de rugby d’Auch. Le F.C.A. est le Football-Club auscitain, prononcé [fécéa] au lieu de [èfe-cé-a], même par certaines personnes cultivées. Cf. téfécé.
fabrou
n.m. Rebouteux. - Pour te remettre ce genou en place, moi je ne vois qu'une solution, c'est d'aller voir le fabrou de Launaguet, eh ! (Même origine OCC. que fabre : forgeron).
face (en)
adv. - Tu as vu qu’il a planté un cerisier en face la maison ? ... en face de la maison. Se cons-truit souvent sans préposition en parler méridional.
fâché
part. - A lui, je lui parle plus, je lui suis fâché ! ... je suis fâché avec lui. Voir copain.
fada, fadorle
adj. Fou, mariole, dingue, écervelé. 1.- Il est complètement fada, ce mec ! (De l'OCC. fat-fada). 2. - Tu as vu à quelle heure tu rentres ! Il faut être complètement fadorle pour traîner dans les rues à quatre heures du matin avec ce qu'on voit de nos jours ! (De l'OCC. falord). ITAL. balordo. Voir bestiasse, branque, cabourd, caluc, caouèc, dévarié, estimbourlé, fait, falourd, madur, mafre, pec, pét au casque, pépiòt, pirol, timboul, voyage..
fadàs, fadasse
adj. Très fade, insipide. - Tu trouves pas que cette soupe est un peu fadasse ? (occitanisation du mot FR. fade).
faire
Ce verbe, très employé en FR., l'est encore plus dans le parler méridional. On peut dire que c'est un verbe à tout faire. 1. - Alors, quel temps il a fait aujourd'hui ? - Eh bé il a fait du brouillard ! Hier il a même fait du verglas ! : il y a eu du brouillard... on a eu du verglas... (On dit aussi faire de la pluie, faire de la rosée : pleuvoir, y avoir de la rosée). - Alors, il pleut ? - Bô, il te fait trois gouttes, juste pour mouiller la poussière...! ...il tombe trois gouttes. 2. - Et le petitou, il va bien ? - Ne m'en parlez pas il me fait angine sur angine ! 3. Jouer. - Le dimanche après-midi, je m'en vais faire aux boules à Héraclès. / - Les garçons, ils sont partis faire au foot aux Minimes ! / Ils font à celui qui criera le plus fort ! 4. - J'aime bien acheter de la viande chez Caporal, il fait de la bonne viande : ... il sert, il vend... 5. - A ce travail, il faut s'y faire pour réussir ! : ...il faut persévérer, donner le meilleur de soi-même. 6. - Faire les ans : fêter son anniversaire. - Et pourquoi vous vous faites la bise, il y a quel-qu'un qui fait les ans ou quoi ? 7.- Fais un bisou à tati, qu’on s’en va ! :... embrasse... (donne un baiser) 8.- Je me fais bien avec lui, ça me rendra peut-être service. : ... je me mets dans ses bonnes grâces. 9.- Se faire avec une fille : voir fréquenter. 10.- Faire mal : Incommoder. - Ne mange pas tant, ça va te faire mal. / - Ouille ! Je me suis contrefaite en voulant attraper un pot de confiture ! - Et tu t’es faite mal ? - Non, mais j’aurais pu... ... tu t’es fait mal ? (accord incorrect en FR., mais fréquent dans le Sud). 11. expr. - Vouloir faire ou ne pas faire : vouloir marcher (ou pas) comme il faut. - Ya pas à dire eh ! quand ça veut (pas) faire, mille dieux !!! … : ... quand ça veut (pas) marcher... 12. expr. - Fais un peu de lumière, que j’y voie ! : Allume... 13. expr. - Ces chaussures neuves me font mal. Il faudra que je les supporte jusqu’à ce qu’elles se fassent ! : ... jusqu'à ce qu’elles s’adaptent à mon pied, qu'elles s'élargissent. 14. - Il est malin celui-là, tê ; rappelle-toi qu’il sait y faire ! : ... il sait se tirer de toutes les situations, il s'y prend bien. 15. expr. - Oh ! Lui il se le fait facile ! : ... Il ne se casse pas la tête pour ça, il sait tirer la couverture à lui. 16. Faire tu, faire vous : tutoyer, vouvoyer. - Je lui dis de me faire tu, il continue de me faire vous ! 17. - Avec la pluie qui est tombée, il a dû s’en faire des cèpes, eh ! : ... en pousser. 18.- Si on continue à travailler à ce train-là, à midi on lui aura fait mal à ce mur, eh ! : ... on aura avancé en ouvrage... Voir aussi : bourre (toucher la). 19. Faire lune : Mystère de la météorologie, dans le Midi il fait lune quand le soleil tape très fort.
faïs
n.m. 1. Fardeau. 2. Tas. - Si tu veux du bois, viens en chercher, j’en ai tout un faïs derrière la maison ! (De l'OCC. fais : fagot ; paquet). vx FR. faix, ITAL. fascio, ESP. haz, CAT. feix.
fait (être)
part. pass. du verbe faire. 1. Ivre. . 2. Cinglé. - Mais regarde-le çui-là à quelle vitesse il arrive ! Mais il est complètement fait ma parole ! (Allusion au melon qui, lorsqu'il est fait, est mûr - voir ce mot - et par conséquent immangeable ou comme le fromage peut être fait) : il est fou, il est madur à point, il est caouèc.
fait-exprès
Expr. - C’est comme un fait-exprès ! :... comme si c’était fait exprès.
falourd
adj. Etourdi ; un peu fou ; sot (De l'OCC. falord). ITAL. balordo. Voir bartole, caouèc, counét, counifle, indjaourit, innocent, maché, estimbourlé, pépiot, pirol, piroulét, tatagnole.
falsaïre
n.f. 1. Garce. 2. sorcière. (De l'OCC. fals-a : faux-fausse). Voir carnus, dame, garce, gri-sette, jeune-fille, madonne, marâtre, ménagère, ménine, mounèque, nénette, patronne, pou-souère, sansogne.
falsebèstieuu
n.f. Hypocrite, faux. (Francisation de l'OCC. falsa bestia : m.à m. bête fausse). - Mon voisin ? Ne m'en parle pas ! C'est une falsebèstieuu ! Il fait semblant de te dire bonjour, et après il va te crtiquer dans ton dos!
fan, éfan, fantounel, fantou
n.m. 1. - Enfant - Oh ! Fan !... Qu’est-ce que tu me racontes là ? (Mon pauvre enfant. Sens voisin ici de " Oh ! La la ! "). Marque l’étonnement ou l’admiration. /- Oh ! Pauvres éfans, quelle vie qu'on mène nous autres ! 3. fantou, fantounel, éfan : petit. - Oh ! Fan de chi-chourle ! Aussi : fan de pieds ! De l’OCC. efant). LANGUEDOC.
fangassière
n.f. Garde-boue. - Avant, quand on partait à vélo, on avait pas peur de traverser les champs, même quand il pleuvait ! Je te dis pas comment on s’enfanguait ! Après, il fallait enlever la boue des fangassières avec un baton ! (De l'OCC. fangassièra : morceau de cuir destiné à ga-rantir de la boue l’essieu de la charrette). ITAL. infangarsi, ESP. enfangarse, CAT. enfangar-se : s’embourber.
fangue
n.f. Boue, gadoue, gadouille. (De l'OCC. fanga [pron. fàngo]) FR. fange, CAT. fang, ITAL. fango. Voir enfanguer. En GASCOGNE : hangue. Voir bardouille, bouillaque, enfanguer, paillebart.
fangueux
adj. Fangeux. - Si tu t’en vas à la mare, mets-toi les bottes en caoutchouc, parce que là-bas, c’est fangueux (Il y a de la fangue). De l'OCC. fangós [pron. fangous]. CAT. fangós, ESP. fango-so, ITAL. fangoso, même sens. Voir enfanguer.
Fanny (être)
expr. Terminer sur un score nul à la pétanque. On dit aussi : Embrasser Fanny, baiser Fan-ny, baiser le cul de Fanny, pour : perdre par 13 à zéro, et : Mettre quelqu'un Fanny, pour : gagner par 13 à zéro.
farci
Farci, farçou 1. n.m. Farce. - La poule farcie c’est rudement bon... Mais il faut savoir faire le farci ! (De l'OCC. farcit) CAT. farcit. 2. Le farçou se confectionne avec des feuilles de blettes, de la chair à saucisse (autrefois, avec le reste du lard cuit de la soupe), de l'aïl, du persil, un œuf, du pain trempé et de la farine, le tout bien mixé et frit dans une poêle. 3. expr. Couper le farci : Porter la culotte. - Chez eux c'est elle qui coupe le farci, c'est pas lui ! - Oh, eh bé, pauvre, il en faut un ! (Expr. OCC. copar lo farcit : être le maître). Voir patronne.
fargué
loc. Être mal fargué : être mal habillé - Arrange-toi un peu ! Tu es toute mal farguée ! (De l'OCC. malfargat). Voir afargué, arranger, débraguer, dégaillé, dégargaillé, déjarguer, despa-patcher, despipadé, ensacher, jargué, marquer.
farine
expr. Se retrouver le nez dans la farine : Être pris au dépourvu, obtenir le contraire de ce que l’on avait prévu, se retrouver comme un crétin.
farinettes
n.f.pl. Crème à base de farine sucrée et de chocolat. (De l’occ. farinetas : bouillie pour en-fants). CAT. Farinetes : bouillie ; plat populaire se composant de farine de céréales, d'eau, d'huile et de sel.
farlabique
n.f. Frelatage, falsification (vins, alcools,…). (De l'OCC. farlabica). Voir alambiqueur, barral, barricou, Bourrou, couler, gabel, pintou, riquiqui.
farnac
n.m. Gros repas - Quel farnac qu'on s'est mis au repas des chasseurs ! Moi je dis… c'était même trop ! Voir afart, bâfras, farnat.
farnat
n.m. Pâtée des porcs à la farine de maïs ou au son ; mélange de choses diverses, peu élé-gant. (De l'OCC. farnat). CAT. farnat : mélange de mets. Voir farnac.
farnous
adj. Morveux - Essuie-toi la bouche, que tu es tout farnous ! (OCC. farnós [pron. farnous] : sale, barbouillé). Voir estron, mécut, merdous, brastous, camaïer, mouscaille, moustafa, mouster, moustous, pégueux.
farou
n.m. Chien de berger (De l'OCC. faró). Voir caporal.
fart
adj. voir hart.
fasti, fastis
n.m. 1. Dégoût, répugnance. 2. - Faire des fastis, être dégoûté, faire des manières ou des façons, être fastigous. Voir estoufignous. (De l'OCC. fasti) CAT. fastic.
fastigous
adj. Difficile, qui se dégoûte facilement Se dit notamment de celui qui enlève dans son as-siette le gras du jambon ou de la viande. (De l'OCC. fastigós, fastidieux, rassasiant, dégoû-tant). CAT. fastigós : dégoûtant, écœurant, dégueulasse. Voir espépisser, estoufignous, nicous, tchaoupiller.
fatche
n.f. Face. Oh! fatche de… (En général, … de con ou de rien du tout, cela dépend…). (De l'OCC. fàcia). ITAL. facia [pron. fatchia].
fatigué
adj. 1. Euphémisme pour "à l'article de la mort". - Tu avais su que son grand-père était mort. - Eh non... J'avais su qu'il était fatigué, mais... 2. Être complètement ivre. Voir bandé, béouét, coufle, cufelle, empaffer, empéguer, hart, joli, pété, pinté, sadoul, tenir (en ~ une)
fatiguer
v. Touiller, remuer la salade pour l'assaisonner parfaitement. En réalité, c'est le ‘fatigueur’ de salade et non celle-ci qui fini par être fatigué au moment de la manger.
faux
adj. Mauvais, vénéneux (pour un champignon). - Ne ramasse pas ceux-là, malheureux, c'est des faux ! NB. Confusion due au qualificatif faux associé à certains champignons vénéneux (la fausse oronge par exemple). Voir moussalou.
faysses (à)
dans l'expr. - Il pleut à faysses : il tombe des cordes (De l'OCC. fais [pron. fayss], fagot, pa-quet). Voir abat d'eau, chagat, délaouatz, goutte, liabas, plège.
fécos (faire)
expr. Faire le carnaval (région de Limoux - Aude). La période du Carnaval de Limoux s'étend sur un si grand nombre de semaines (onze) qu'il est, très vraisemblablement, le plus long carnaval du monde, même si la ville ne fait pas carnaval -fécos - chaque jour pendant toute cette période. En effet, outre le Mardi-Gras des origines, masques et musiques ne sortent que chaque samedi et chaque dimanche, en dehors de la semaine folklorique qui déroule ses fastes autour du Mardi-Gras.
fède
n.f. Brebis - Regarde ce troupeau de fèdes autour de la lavogne. (De l'OCC. feda). Voir la-vogne.
fégnantas, fainéantas
adj. Grand paresseux - Il n’en fout pas une rame de toute la sainte journée, ce fégnantas ! (Suffixe augmentatif occitan -as associé au mot FR. fainéant)
fégnantéjer, fainéantéjer
v. Fainéanter, paresser. - Qu’est-ce que tu as fait dimanche ? - Bôa ! j’ai fégnantéjé toute la matinée ! (Adaptation au FR. fainéant du suffixe OCC. -itjar du verbe prigritjar : fainéanter). Voir balént, barranquine, bras-cassé, fégnantas, février (être né en), galapian.
feigue
n.f. Enfant polisson, malin, rusé. (Origine incertaine).
feinter
v. Sécher le cours. - Demain il y a un contrôle de maths de trois heures ! J’aurais bien envie de feinter moi !... ARGOT MÉR. Influence du mot rugbystique feinter. ITAL. far finta : faire sem-blant.
félut
adj. Mal coiffé. - Ça doit sacrément buffer dehors, parce que t’es tout félut ! (De l'OCC. felut : velu). Voir buffer.
femme
n.f. Employé avec l'article : épouse. - Et où tu as la femme ? - Oh bé elle prépare la soupe ! (En OCC. on dit l'ome, la fenna, pour dire ton mari, ta femme). On dit aussi la fille, le fils… pour dire ma fille, mon fils. ITAL. on dit la moglie (la femme) pour dire ma femme.
fémourier
n.m. Tas de fumier. - Tu as des soucis ? Fais comme le coq, toute la journée sur le fémourier, et ça ne l'empêche pas de chanter. (De l'OCC. femorièr : fosse à fumier).
fénestrou, finestrou
n.m. Soupirail, vasistas... - Comme je voulais pas rester fermé dehors, je suis passé par le finestrou du garage ! (OCC. : fenestron). ITAL. finestrino. NB. en CAT. finestró : volet.
fénétra
D'après Louis Alibert, le fénétra est un pardon qui se gagne à Toulouse en carême et aux fêtes de Pâques en visitant les maladreries des faubourgs ; par extension, réunions de dévotion et parties de plaisir où l'on danse. D'après Simin Palay : Autrefois à Auch, foire où les domestiques venaient se louer. A Toulouse on parle de Grand Fénétra. Il s'agit d'une fête populaire qui se tient en début d'été et où se déroulent des spectacles de danses de chants et musiques traditionnels donnés par des groupes venus de France et d'ailleurs. (De l'OCC. fenetrà ou feletrà).
fennasse
n.f. Femme grossière, peu fine. - Ma femme, c'est pas un fétu de paille comme la tienne mon pauvre Marcel, c'est une vraie percheronne ! - Ouais, une fennasse, quoi ! (De l'OCC. fenna : femme, suivi du suffixe dépréciatif - assa [pron. fennàsso]).
fennassier
adj. Séducteur, homme à femmes, coureur de femmes. - Ah ! Ça y est ! Il a réussi à se marier quand même ce fennassier, à cinquante cinq ans passés ! (De l'OCC. femnassièr, lui-même de femna : femme). Voir fumelier, putanier.
ferlup
n.m. Gorgée de vin bue en faisant du bruit dans un verre rempli à ras bord, que l'on ne porte pas à la bouche.
ferluper, farluper, hurluper
v. 1. Humer 2. Sucer, boire un verre trop rempli, boire d'un seul trait 3. Manger de baisers. (De l'OCC. ferlupar). Voir ferlup.
fermer, enfermer
v. 1. Enfermer. - Bernardo, tu as fermé le chat ? … enfermé le chat. / Tê ! Je m'en vais fer-mer les poules, qu'il va faire nuit ! ... fermer la porte du poulailler. 2. Se fermer : s'enfer-mer. - Pourquoi tu te fermes comme ça ? Tu as peur des voleurs ou quoi ? 3. Se fermer : v. Expression météorologique : Le temps s'est fermé : Il fait mauvais temps. 4.- Le gosse, il est allé aux cabinets et... je sais pas comment il s’est débrouillé, pauvre, il est resté fermé (ou enfermé) dedans ! / La femme est partie avec la clé et on est resté fermé (ou enfermé) dehors pendant une heure ! Tu le crois, ça mille dieux ? : Ces deux expressions indiquent l’impossibilité d’entrer ou de sortir. (Expressions particulièrement saugrenues puisqu’en pays d’Oc on peut être enfermé... même dehors !).
fessou, fessoul, foussou
n.m. - Le fessou sert au sarclage et au binage de la vigne. (OCC. fesson [pron. fessou]). Espèce de houe pointue ou de pioche qui permettait entre autre de creuser le sillon et de rejeter la terre de part et d'autre en vue du semis. Voir andusac, bécat, bêche, bézouy, bigos, houe, majunquer, paloun, pelle-bêche, pelleverser, sarclét.
feu
1. Voir arrêter (le feu). 2. expr. C'est du feu qui tombe! ou il tombe du feu ! : le soleil cogne. Se dit lorsque l'on sort vers 2 heures d'une après-midi d'été et que l'on reçoit d'un coup toute la chaleur sur le corps.
fève
n.f. Gland du pénis. Appelé aussi pois chiche. (De l'OCC. fava, [pron. fàbo], même sens). Voir asperge, bique, poireau, pois chiche, quique, quiquette, riuchiuchiu, sguègue.
février
expr. Être né au mois de février : être fainéant - Rappelle-toi que celui-là, il n'est pas très vaillant. Il doit être né au mois de février sans doute... Ou peut-être un dimanche, qui sait ? (allusion à la longueur de ce mois qui n'a que 28 jours et, donc, moins de jours de travail).
ficelle
n. 1. Très grand et très mince - Oh ! qu’il est ficelle ! Et combien il mesure ? Au moins un mètre quatre-vingt-dix, non ? 2. Dans un autre contexte on parle de ficelle de lieuse pour désigner une ficelle plutôt épaisse et solide qui servait autrefois à nouer les gerbes.
ficelon
n.m. Ficelle de boucher. - Le ficelon sert, en GASCOGNE, à la confection du saucisson et des rôtis. (Du GASC. : ficelon [pron. ficélou]).
fier
adj. Grand et fort.- Elle ne ressemble pas du tout sa mère ; elle est beaucoup plus fière qu’elle ! : plus grande, charpentée... - Tiens-toi fier ! : Porte-toi bien (Dordogne). Faire le fier : expr. Snober - Tu trouves pas qu'il fait un peu le fier depuis qu'il est maire, le Raymond ? Voir balès, cacou, gaillard, quèque ; despendjorlard, ficelle, galé, grandas, grandét.
figue
n.f. Sexe de la femme. Comme souvent en langue méridionale le sexe de la femme évoque quelque chose de sucré ou de parfumé. Voir beignet, bergamote, buffe, nature, patchole.
filet
n.m. Fil de fer. - Autrefois on attachait les bottes de foin avec du filet, maintenant on prend de la ficelle en plastic, c'est plus léger. Voir plastic.
finir
v. Dans l'expression finissez d'entrer ou achevez d'entrer : ne restez pas sur le pas de la porte, entrez donc !
fion
n.m. Remarque désobligeante et acerbe. - Celui-là, il sait pas parler à quelqu'un sans lui en-voyer un fion. (De l'OCC. fion [pron. fiou] adresse ; bonne tournure ; brocard ; mot piquant ; chagrin ; inquiétude)
fioulét, fiolét, fioularel
n.m. Sifflet - Ah ! Je sais plus où j'en suis, tu m'as coupé le fioulet (De l'OCC. fiulét ou siulét). CAT. xiulet. Voir chioulét.
flambadou
n.m. Capucin ou cornet métallique percé à son extrémité, muni d'un manche, que l'on fait rougir au feu et dans lequel on introduit une tranche de lard qui en fondant permet d'arro-ser la viande qui rôtit à la broche. Est également utilisé pour arroser de beurre le gâteau à la broche. (De l'OCC. flambador [pron. flambadou]). Voir flambusquer.
flamber
expr. Flamber la mique : Manger avec beaucoup d’appétit. (De l'OCC. mica : mie).
flambusque
n.f. Vol, fauche - Si tu vas aux puces, fais gaffe à la flambusque ! Voir arpaillan ; estamper, flambusquer, tchourer.
flambusquer
v 1. Arroser de lard fondu une volaille au tourne-broche. Cette opération se pratique grâce à un "flambadou" (capucin en FR.), espèce de cône métallique muni d'un manche, que l'on fait chauffer à blanc et dans lequel on place un morceau de lard qui en fondant coule lentement sur la viande et lui donne une saveur sans pareille. (De l'OCC. flambuscar). 2. Flamber, passer une volaille plumée à la flamme. - Autrefois nous autres on flambusquait les poulets sur le gaz, maintenant j'ai ma sœur qui le fait avec un petit chalumeau camping-gaz ; eh bé tu sais que c'est pas malcommode ? 3. ss. figuré : flamber, plumer. - Je me suis fait flambusquer à la bourre (jeu de cartes) : J'ai tout perdu, je me suis fait plumer.
flêchard
n.m. Fronde. A l'école primaire, dans les années cinquante, chaque garçon (ou plutôt garçou-nas) avait son flêchard, réalisé à l'aide d'une fourche en bois d'une trentaine de centimètres de haut, munie de deux élastiques découpés dans une chambre à air de voiture et solidement attachés aux branches de la fourche, avec du ficelon. Un morceau de cuir de vieille chaussure faufilé à l'intérieur des élastiques servait de réceptacle au projectile, une pierre ou parfois même... un boulon ! Ce terrible appareil destiné en principe à abattre des moineaux, était rarement utilisé à cet effet. Il s'agissait en fait de décaniller des boites de conserves posées sur un piquet de clôture et, à l'occasion, de casser les carreaux des maisons abandonnées. Un instrument, en fait, dont la détention aujourd'hui dans une enceinte scolaire, entraînerait une exclusion ou, à tout le moins le conseil de discipline !
flemme
expr. Ne pas y aller de flemme : Ne pas y aller de main morte. - Il te lui a donné une paire de baffes, con ! il y est pas allé de flemme ! GASCOGNE.
flémou
n.m. Petite flemme. - Je m'en vais faire un petit siestou. J'ai un petit flémou. (Suffixe occitan -ou ajouté au mot FR. flemme). Voir cugne, cuque.
flèou
n.m. Voyou, dur, mauvais garçon, loubard - Les flèous de St-Cyprien, comme la plupart des habitants de ce quartier de Toulouse, avaient un accent et un argot bien particulier, dont de nombreux exemples figurent dans ce lexique. Voir argagnol, arapaillan.
flisquét
n.m. Loquet. - Tê, il faut qu'on s'en retourne pasque je sais pas si j'ai fermé le flisquét du ga-rage, que si la chatte elle s'échappe, elle va se faire écraser, non d'une pipe, macagnon ! (Mot OCC.).
floc
n.m. Floc de GASCOGNE : apéritif gascon. Simin Palay donne du floc la définition suivante : Fleur de grande taille ; bouquet ; grappe ; ce qu'il y a de mieux sur une place de marché, le surchoix. - Donc le floc, ça ne doit pas être mauvais !
foi (ma)
expr. typiquement méridionale. - Alors Mamie ça va ? - Ma foi ! … Ce qui signifie que Ma-mie le fait aller. / - Tu veux aller te promener Mamie ? - Ma foi ! : Ici ce "ma foi" est plutôt un "pourquoi pas". Quoi qu'il en soit, il y a peu d'enthousiasme dans la réponse de Mamie.
foirail
n.m. Dans le Centre et le Midi, le foirail est le champ de foire. Le LAROUSSE admet ce mot comme régionalisme.
fois
expr. 1. Les autres fois : Avant ; auparavant, autrefois. – Ah ! Mais maintenant, c’est plus comme les autres fois ! (De l'OCC. autres cops). 2. Une fois en passant : de temps en temps. - T'aimes pas le saucisson Lulu ? - C'est pas ça, mais le docteur m'a interdit d'en man-ger ! - Oh ! une fois en passant, ça va pas te tuer !
fond
n.m. Bout, extrémité. - Il est descendu en courant jusqu'au fond de la côte ! :... au bas de la côte. - Les vaches sont parties au fond du pré ! : de l'autre côté du pré. ... Au fond de l'étable : à l'autre bout de l'étable
fontaine
n.f. - Simone ! Tu sais pas où il est mon tricot ? Je l’ai pas trouvé dans l’armoire ! - Oh ! Toi, de toute façon tu ne trouverais pas de l’eau à la fontaine ! A l’adresse des paresseux (sou-vent du genre masculin) qui ont besoin d’assistance (souvent féminine) pour mettre la main sur un objet. Voir Garonne, glisser.
forcaillou
n.m. Un "forcap" encore jeune. (Du FR. caillou : cabochard, associé à l'OCC. forcap) Voir cail-lou, forcap.
forcap
n. et adj. Forte tête. - Pour lui faire entendre raison, on a du mal ; c'est un forcap vous savez ! (OCC. fòrt cap: forte tête). Voir amòri, cabourd, caillou, capillier, clusque, cuque, fatche, mour.
fort
expr. Ne pas être fort à quelque chose : Ne pas être enclin à faire quelque chose. - Moi au champagne j'y suis pas fort. Je préfère finalement un bon bordeaux que non pas du cham-pagne !
fouace
n.f. Pâtisserie aveyronnaise en forme de galette - La meilleure fouace, c’est à St-Cyprien qu’on la trouve, Madame ! (De l'OCC. fogassa [pron. fougàsso]). CAT. fogassa. (NB. ESP. hogaza : miche de pain).
fouacét
n.m. AUDE en particulier : Biscuit, galette, petit-beurre (De L'OCC. fogassét).
fougasse
n.f. Fouace. Ce mot est surtout employé dans LANGUEDOC, en Lozère notamment pour désigner une pâtisserie en forme de couronne, appelée fouace en Aveyron, coque dans la région de Toulouse, tourteau dans le Gers, etc. CAT. fogassa. (NB. ESP. la hogaza est la miche de pain). Voir coque, fouace, limoux, tourteau, royaume.
fougner
v. 1. Fouiller. 2. Fourrer en poussant dans un tiroir déjà bien plein. - Ah ! C'est comme ça que tu plies tes affaires ! En les fougnant dans la commode ? (De l'OCC. fonhar [pron. fougnà]. Voir fourguigner, fureter, hurguer, trafiquer, trifougner.
fourguigner
v. Fouiller. (Voisin du v. OCC. forgalhar). CAT. furgar, ESP. hurgar : fouiller. Voir trifougner.
fourmetser
v. Enlever le fumier - Il faut fourmetser les lapins de temps en temps si on veut pas qu'ils en aient jusque par dessus les oreilles. (De l'OCC. femorejar avec une confusion probable avec un verbe à la sonorité voisine : formatjar, mais celui-ci signifie "faire des fromages" !). Voir fémourier, galinasse.
fournét
n.m. Fourneau, extérieur ou dans l'étable, destiné à cuire les aliments pour le bétail. - Dans le temps, on faisait cuire les patates pour les cochons dans le fournét. (De l'OCC. fornét).
fournière
n.f. Four de boulanger, fournil (De l'OCC. fornièra). La pièce où l'on faisait le pain autrefois et qui sert aujourd'hui le plus souvent de débarras.
foussou
Voir fessou.
foutral
n.m. Chose imposante, grosse. - Je suis passé devant chez l’Edouard. Tu as vu ce foutral de maison qu’il a maintenant ? (De l'OCC. fotral [pron. foutral]). Voir barrique, engraisser, gigot et grain d'aïl, profiter, quelque chose.
foutu (mal)
adj. Malade, souffrant. - Alors, comment il va le Jeannot, eh ? - Oh, ça fait trois jours qu'il est mal foutu. Il est pas encore foutu, mais il est foutu de rester à la maison une semaine encore, ce macarel ! Je sais pas qui c'est qui m'a foutu un type pareil, nom de nom ! Voir agacis, crébère, lancer, mal (avoir du), patchaque, pét de travers, pierres (soufrir les), poutingue, requinquiller, tras. En FR. mal foutu signifie être mal bâti, mal proportionné.
fouyre
n.f. Diarrhée. -Je crois que j'ai trop mangé d'abricots, j'ai attrapé la fouyre ! - C'est pas que t'en manges trop, c'est que tu n'attends pas qu'ils soient mûrs, toi aussi ! Attention, si on va à l'étranger, fouyre se traduit par turista. (De l'OCC. foira [pron. fouro]). Voir cagagne, ca-gasse, caguère.
frais (de)
expr. 1. En bon état. - Tu as bien fait de m’offrir un sac à main, que j’en avais aucun de frais ! ... aucun de vraiment en bon état. 2. Depuis peu. - Il est fait de frais le café, ou il est de ce matin ? (De l'OCC. fresc : neuf, propre).
francimand, franchimand
n.m. Dans son Dictionnaire de la Catinou, Charles Mouly définit ainsi le franchimand : "Pour nous sudistes, les franchimands sont les Français d'au-dessus de la Loire. Le français est leur langue naturelle et ils parlent pointu - Voir ce mot - alors que nous, nous parlons plat". De quelqu'un qui cherche à cacher son accent méridional, (autrement dit, à renier ses origines !) on dit qu'il francimandèje (De l'OCC. francimandejar). Voir caouèc, diable vert, gabatch, montagnol, Pays-Bas, Pimpous, pouraille, rester.
francimandéjer
v. Affecter de parler le français avec l'accent du Nord (de la Garonne, à Bordeaux, de la Loire en tout cas). Voir francimand.
frapanard
n.m. Voir tabanard
fréquenter
v. Sortir avec (un garçon ou une fille)- Vous dansez mademoiselle ? - Non, pauvre, je ne peux pas, je fréquente... (De l'OCC. frequentar). Voir causer, parler.
fristi
n.m. Nourriture, repas, frichti, - Qu'est ce que tu nous a préparé comme fristi ? (Origine incertaine. Rapprochement possible avec l'allemand frühstück : déjeuner ; cependant no-tons que fristolhar signifie festoyer en GASC. et que la fristòlha est un plat de fricot, plus abondant que délicat, ou une ratatouille). Voir brespail, crusques, déjeuner, dîner, escou-bassat, esprantiner, graillou, manger, mongétade, souper.
fritons
n.m. Rillons. - Ce soir il y a du pâté, du jambon et des fritons de canard. On va se régaler ! (De l'OCC. fritons). Voir chichou.
froid
expr. Avoir le froid dessus : avoir froid du fait que l'on ne s'est pas suffisamment couvert en sortant, ou que l'on a "ramassé froid" et que, bien que l'on se couvre abondamment on n'arrive tout de même pas à avoir chaud (ou même à "ramasser chaud"). Ce n'est pas simple. - Brrr ! Je suis resté dix minutes à attendre le bus, et maintenant j'arrive pas à me réchauffer, j'ai le froid dessus !
froustougner
v. Froisser. - T'as la robe qui froustougne ; elle est toute froustougnée. (de l'OCC. frostir pron [froustí]: froisser, suivi d'un suffixe colorant -ougner)
fum (à)
loc. A fond, à toute vitesse - Alors, il prend la moto et... à fum à dabaler la côte ! (De l'OCC. a fum -fum : avec de la fumée. GASC. a hum !). Voir bomber, bringue, brullos, coup (d'un coup de).
fumace
exp. Être fumace : être en colère (De l'OCC. fumace : rage, colère fumante). NB. Ce mot existe dans les dictionnaires de l'argot FR., mais orthographié fumasse. Voir inquiéter, rogne, ruque.
fumelier
n.m. Coureur de jupons, homme à femmes (Du GASC. fumela : femelle). Voir cagnas, fennas-sier, putanier, queutard, traquer.
fure
n.f. Drague, action de courir les filles. (de l'OCC. fura : capture, découverte excelente). Voir causer, fennassier, parler, putanier.
furer
v. Draguer, courir les filles. (De l'OCC. furar : fureter, chasser au furet).
fureter
v. Fouiller avec acharnement. - Mais qu'est-ce que tu furètes partout comme ça ? Tu vas me démolir la maison !
fuste
1. n.f. Bâton fin et souple. (De l'OCC. fusta). ESP. fusta : cravache. 2. expr. Partir à fuste, LANGUEDOC, à hute, GASCOGNE : prendre la fuite, déguerpir. (De l'OCC. futa ou du GASC. huta : fuite).
fut, fut !
Onomatopée destinée à chasser les chats ou les enfants - Allez, fut ! fut ! Sors-toi de devant que tu encombres ! (De l'OCC. futa : fuite).
futaille volante
expr. Se disait des tonneaux tels que les bordelaises et même les demi-muids (600 litres), pour les distinguer des foudres (11.500 litres).
G
gabatch
n.m. Étranger ; celui qui parle une langue étrangère ; gavache, de la montagne ; Audois pour un Roussillonnais, Aveyronnais pour un Héraultois. On est donc toujours le gabatch de quelqu'un. (De l’OCC. gavach : Goinfre ; goulu ; rustre ; grossier ; montagnard ; langage étranger, patois). ESP. gabacho : canaille; celui qui vient du Nord (dans ce cas donc, les Français.) CAT. gavatx : gavache, montagnard des Pyrénées françaises, Français. Le terme "gabatch" selon d'autres sources serait dérivé de l’espagnol "gavacho" signifiant "canaille" et désignant toujours celui qui vient de plus au Nord. En Roussillon, les gavachs sont les Languedociens, en Languedoc, ce sont les Auvergnats, en GASCOGNE du Nord (Médoc, ou Entre-deux-Mers par exemple), les "gavaches" sont les voisins de langue d'oïl, donc les Cha-rentais. Dans l'Aveyron les gabatchs sont les habitants de Laguiole.
gabel, gavel
n.m 1. Sarment de vigne. Voir asaigher, barquet, bigos, bourre, Bourron, cabeçal, fessou, majunquer, pichobi. 2. expr. La tisane de gabel : le vin.- Tu préfèrerais du café, de la verveine ou du tilleul ? - Oh ! pour moi ce serait plutôt de la tisane de gabel, si ça ne te fait rien… (De l'OCC. gavèl [pron. gabel]). Voir alambiqueur, barral, barricou, couler, farlabique, pintou, riquiqui.
gafarou
n.m. Fleur des champs velue, poussant dans les lieux incultes, qui a la particularité de s'accrocher aux vêtements de laine. - Tu t'es couchée dans l'herbe ou quoi, que tu as le tricot plein de gafarous ? (De l'OCC. gafaron). Voir agafaròt, agafou, bourrichon, gahisse.
gafét
n.m. 1. Gamin.- Eh ! Tu as vu son mari ? Mais quel âge il a... qu'on dirait un gafét ! 2. Adolescent, apprenti. - Sur le chantier, tout seul j’y arrivais plus, alors j’ai pris un gafét pour m’aider à travailler. (Mot GASC.). Voir cagòt.
gageot, gagette
n.m. et f. - Cageot. Cagette.- Les salades, tu les mettras dans des gageots et les fraises dans des gagettes !
gagner
v.t. 1. Vaincre, battre, remporter. - Allez, dépêche-toi de manger ta soupe sinon je vais encore te gagner ! : … je vais te battre, je vais finir avant toi. 2. gagner (se le). expr. Méri-ter. - Eh bé, il faut se le gagner, eh ! (en parlant d'un travail difficile ou épuisant qui rap-porte peu) : ... il faut (se) le mériter.
gagnoler
Voir cagniouler.
gahisse
n.f. Bardane. (GASC. gahis). Voir agafaròt, agafou, bourrichon.
Gaillac et Rabastens (être entre)
expr. Etre quelque peu éméché. - Il n’est pas très clair, le Gastounet ! - En effet, je sais pas ce qu'il a fait cette nuit, mais ce matin il est entre Gaillac et Rabastens! Gaillac et Rabas-tens : deux bourgs du Tarn, producteurs de vin de Gaillac.
gaillard, gaillardét
adj. Costaud, en forme. (De l'OCC. galhard, galhardet : bien portant). CAT. gallard, ESP. gallar-do, ITAL. gagliardo, même sens. Voir balès, cacou, fier, gailloufard, quèque.
gailloufard
adj. Costaud, en forme - Alors Madame Lavergne, il va mieux votre mari ? - Il va un peu mieux, mais encore il n’est pas bien gailloufard ! (De l'OCC. galhofard : bien portant). Voir balès, cacou, fier, gaillard, quèque.
galapian
n.m. Galapiat, Vaurien, fainéant. - Ce gosse, alors ! On n’en fera rien ! C’est un véritable galapian ! (De l'OCC. Galapian : goinfre ; vaurien ; grand garçon paresseux). Voir balént, bar-ranquine, bras-cassé, fégnantas, fégnantéjer, février (être né en).
galé (grand)
n.m. - Un grand galé c'est un jeune, grand, pas très gros, plutôt nonchalant, pas très "vaillant" et peu harmonieux. (Origine incertaine) Nombreux sont ceux qui pensent que grand galé est "gringalet" en FR. Il n'en est rien, bien entendu. Voir counas, despindjolard, fégnantéjer, ficelle, fier, grandas, grandét.
galet (à)
expr. Boire à galet : boire à la régalade. (Du GASC. galet : goulot de la bouteille).
galetas
n.m. Combles, grenier en général. - Tu as des tataragnes plein le béret ! Tu viens du galetas ou quoi ? (De l'OCC. galatas, du nom de la tour de Galata à Constantinople). Figure au LAROUSSE dans le sens de réduit misérable. Utilisé en Suisse romande dans le sens de "grenier, combles".
galinasse
n.f. Fumier de volaille, fiente de poule. - Rien ne vaut la galinasse pour avoir de beaux légumes dans le jardin. (OCC. galinassa). ESP. gallinaza, même sens. Voir fémourier, four-metser.
galinette
n.f. Poulette. (De l'OCC. galineta : petite poule ; coccinelle). ESP. gallinita, ITAL. gallinetta : pe-tite poule. Voir glousse, gorger, quéquét, poulet, poulétou.
galinière
n.f. Poulailler. - Je m'en vais faire un tour à la galinière, ramasser un peu de galinasse qu'ont fait les galinettes ! (De l'OCC. galinièra). ESP. gallinero, CAT. gallinaire, ITAL. gallinaio. Voir lapi-nière, poulaillère, pouraille, volaillère,
galopère
1. n.f. Envie de courir, d'aller faire les magasins, de voyager... - Ces femmes, elles ont la galopère ! 2. n.m. & f. Celui ou celle qui aime courir, voyager... (De l'OCC. galaupaire : qui aime courir). Voir courinère.
gamate
n.f. Auge du maçon servant à transporter le mortier. (de l'OCC. gamata ou gama-cha).
ganarre
n.f. Cuite, soûlerie. - ¬On l'appelait la Bandade (la bandée, c'est à dire l'ivrogne), parce qu'elle prenait ganarre sur ganarre, si bien qu'on n'a jamais su comment elle s'appelait réellement. (De l'OCC. ganarra). Voir bandé, béouét, coufle (être), cufelle, empaffer, empéguer, fatigué, hart, hartère, joli (se mettre), murge, pété, pinté, sadoul, tenir (en ~ une).
ganibe
n.f. Gros couteau. - Sans te commander, attrape la ganibe que je coupe le jambon ! (OCC. ganiva). FR. canif.
ganit
adj. Affamé, épuisé par la faim (voir aganit).
ganivelle
1. Palissade confectionnée à partir de fins piquets de châtaignier placés verticalement et reliés par du fil de fer galvanisé. Les ganivelles sont conditionnées en rouleaux. Elles sont utilisées par exemple pour protéger les dunes des Landes ou de Camargue. Elles servent aussi et tout simplement de barrières dans les sites touristiques de bord de mer ou ailleurs. 2. n.f. Personnage imaginaire ou ayant existé dont le patronyme vulgarisé en est venu à signifier : bon à rien, stupide, comme en témoigne l'expression : "Il est comme le chien de Ganivelle qui s'en va quand on l'appelle". (Origine incertaine).
garbure
n.f. Soupe au chou gasconne - Une garbure, ça se confectionne avec des choux verts et de la ventrêche, ça se fait cuire tout doucement dans un toupi, en fonte de préférence et sur le feu de bois si on a les moyens.... (De l'OCC. garbura). Voir tourrin.
garbuste, garabuste
n.f. Bourriche. - Alors, les pescofis, on a la garbuste pleine ? (De l'OCC. garrabusta : panier d'osier, bourriche, filet de pêche). Voir bourguignotte, panière, saque ; calicoba, canabère, fissou, grougnàou, montre, pescofi, piquée, puisette.
garce (filh dé ou hilh dé)
expr. Fils de garce. - Oh ! Filh dé garce, alors ! (De l’OCC. filh de garça). Juron utilisé par les gens délicats, comme euphémisme pour filh dé pute qui est, vous l'avouerez, franchement moins élégant ! Aussi : Réfilh dé garce !
garçonas, garçounas
n.m. 1. Garçon très viril. 2. Garçon manqué, fille qui joue avec les garçons. - Elle a pas peur d'aller au ruby, tu sais, elle. C'est un vrai garçounas ! (OCC. garçonàs).
gardepile
n.f. Grenier à blé. (De l'OCC. gardapila).
gargaillol, gargagnol
n.m. Voir gargamelle. (De l'OCC. gargalhòl : gosier).
gargamelle
n.f. 1. Oesophage, gosier, gorge. - J’ai failli m’étouffer, j’avais une arête coincée dans la gargamelle ! 2. expr. Tout ça, c’est comme un grain de blé dans la gargamelle d’un âne ! : ...c’est sans importance, ce n’est pas très grave ! NB. Le mot gargamelle figurant au LA-ROUSSE est d’origine OCC.). CAT. gargamella, ESP. garganta, même sens. ITAL. bere a garganel-la : boire à la régalade.
gargoter
v. Bouillonner (pour un liquide). - Il faut que je rentre, Madame Laborde, j'en-tends la soupe qui gargote ! (De l'OCC. gargotar).
gargoule
n.f. Gouttière ou tuyau de descente des eaux pluviales. - Il pleuvait tellement, que l’eau n’arrivait même pas à descendre par les gargoules ! (Déformation probable du mot gar-gouille dont le sens est différent). Voir dalle.
garnir
v.t. Remplir des papiers. Il paraît qu'avec la carte Vitale on aura plus de papiers à garnir ! - Oui, mais il faut pas que tu t'oublies la carte Vitale, sinon tu es marron, couillon, ils te feront encore garnir quelque chose ! (Mot FR.)
garnir
expr. Garnir (la salade) : assaisonner. - Bon, j'ai préparé la salade, mais je ne l'ai pas garnie... Chacun se la garnira comme il voudra. :... chacun l'assaisonnera à son goût. (De l'OCC. garnir [pron. garni] : assaisonner).
Garonne
n.propre. 1. La Garonne. S’emploie sans article à Toulouse et région toulousaine. Comme je ne sais pas quoi faire, je m'en vais pêcher à Garonne avant qu'elle déborde. - Oh, pour que Garonne déborde, il faut quand même qu’il pleuve un peu plus ! (De l’OCC. a Garòna, sans article). 2. Ne pas trouver d'eau sous le pont de Garonne. expr. - Yvonne ! Où tu m'as foutu la chemise ? Je l’ai pas trouvé dans l’armoire ! - Oh ! Toi, de toute façon, tu ne trouverais pas de l’eau sous le pont de Garonne ! A l’adresse des paresseux (souvent du genre masculin) qui ont besoin d’assistance (souvent féminine) pour mettre la main sur un objet. (Voir fontaine). Aussi : Ne pas trouver des cailloux à Garonne : ne pas voir ce qui saute aux yeux. (NB. : Même façon de dire pour Aude, employé sans article par les locaux). 3. Il n'y a pas le feu à Garonne ! : Il n'y a pas le feu au lac, rien ne presse, soyons patients et réfléchissons avant de nous lancer dans une entreprise.
garouste
n.f. Nature. - Après le bal, l'objectif était d'emmener les filles dans la garouste (ou dans la bagnole pour ceux qui en avait une). (De l'OCC. garrosta [pron. garrousto] : garrigue).
garrou
n.m. Jarret de veau. (De l'OCC. garron [pron. garou]). CAT. garrò.
garrut
adj. Fort, costaud. Se dit aussi bien d'une personne que d'un animal. - T'as vu le nouveau pilier ? Il a l'air garrut ! (Du CAT. garrut-uda : qui a de grosse jambes). ESP. garrulo : brut, rustre.
gaspét
n.m. Petite grappe de raisin, grapillon. (De l'OCC. gaspa : grappe).
gastapiane
Voir castapiane.
gâteaux
n.m. Biscuits, gâteaux secs. - A la quine j'ai gagné un kilo de sucre et un paquet de gâteaux, c'est pas mal, eh ? - Oh eh bé si tu t'en contentes, c'est pas mal…
gatemiàoule, gatemiaule
n.f. 1. m. à m. Chatte qui miaule : se dit de quelqu'un qui chante très mal ou très faux. 2. Hypocrite. - La nouvelle épicière, je l'aime pas moi, eh ! Et gnagnagna, et gnagnagna ! C'est une gatemiàoule, tê ! 3. Personne geignarde ou pleurnicheuse. - Qu'est-ce qu'elle m'agace cette pauvre femme chaque fois que je la vois ! C'est pas la peine de lui demander si ça va ! De toute façon, ça va jamais ! Et tantôt c'est la jambe, et tantôt c'est le dos ! Oh, ma-caniche, alors ! Quelle gatemiàoule ! (Du GASC. gatamiaule, lui-même de gata : chatte et miaular : miauler). Voir béchie, falsebèstieu, sounsigner.
gâté-pourri
adj. Se dit d'un enfant capricieux et comblé qui obtient tout ce qu'il veut de ses parents,. - Ce gosse elle ne peut rien en faire, et en plus il est gâté-pourri. (du FR. gâté utilisé dans le même sens, suivi de l'adj. pourri qui renvoie au fruit qui de trop être gâté se pourrit).
gatouner
Voir catouner.
gazaille (en)
expr. 1. Amener une vache (ou autre animal) en gazaille : la conduire chez quelqu'un pour la faire paître. 2. Extension du sens : laisser à l'abandon. - Oh ! son tour de maison, maintenant qu'il est tout seul, il est un peu en gazaille ! (de l'OCC. a la gasalha : au hasard).
générale
n.f. Bagarre générale. -expr. : Déclancher une générale, au rugby notamment.
genou de vieille (tailler comme un)
Voir tailler
gerbière
n.f. Gerbier. (De l'OCC. garbièra : grande meule de gerbes). CAT. garbera. NB. en FR. une ger-bière était une charrette servant à transporter les gerbes).
Gers
Le S est le plus souvent prononcé, mais contrairement à ce que l’on pense, ce ne sont pas forcément les "Parisiens" qui l’omettent. Certains Gersois, aussi, prononcent [ger] et ce n’est sûrement pas par snobisme. Il semblerait qu'aujourd'hui, pour "plus d'authenticité", il soit de bon ton de dire Gersss, quitte à produire des rimes pauvres du style "[poulets] élevés en plein air / élevés en plein Gersss". Autres cas de consonnes finales sourdes : le n de Tar(n) et de Béar(n) entre autres, ainsi que tous les r finaux des infinitifs en OCC. Voir Capvern
gigot et grain d'ail
expr. Se dit d'un couple dont l'un est très gros et l'autre très maigre. - Je viens de rencontrer les nouveaux voisins, et bé eux, c'est vraiment gigot et grain d'ail. Elle doit te faire au moins 150 kilos et lui, il est tout réchichouét que tout mouillé je sais pas s'il en fait 50 ! Voir bar-rique, engraisser, foutral, profiter.
giscler
v. Gicler (OCC. gisclar). Voir chistrer, rechaoupisquer, regiscler.
gitane, gitanous, gitanas, gitou
n.m. - A Sesquières il y a un campement de gitanes. Notons que le mot gitane n'est pas au féminin. [Sa prononciation méridionale est uniquement influencée par l'OCC. gitano]. Gita-nas : augmentatif et péjoratif. Gitou : diminutif mais tout aussi péjoratif. Où l'on voit que le parler populaire ne s'embarrasse pas de complexes racistes, il y va franchement. En effet on peut encore entendre des phrases du genre : - Ils vivent à cinq dans la même pièce, comme des gitous ! [Le s de gitous est le plus souvent sonore, sauf si l'on veut faire plus FR.]. Propos ne datant pas d'avant le politiquement correct.
glinguer
v. Grincer, émettre un bruit désagréable, anormal, indiquant que la chose qui le produit est quelque peu "déglinguée". Voir clasquéjer, cagniouler.
glisser
Dans l'expr. "j'ai glissé à la fontaine" : Cette expr. qui n'est guère employée aujourd'hui, signifiait à peu près ceci : "Je me suis laissé séduire par un garçon et j'ai fini dans son lit, avec toutes les conséquences que cela peut avoir", mais outre que ceci est beaucoup moins poétique, c'est très très long à dire.
gloupéjer
v.i. Mot rencontré dans le sens de renifler, alors que son origine OCC. est glopejar : boire par petite gorgées ; tomber goutte à goutte. Glissement de sens, donc : - Pour éviter que la goutte (du nez !) ne tombe, on gloupèje !
glousse
n.f. Poule couveuse, mère poule. (Amalgame de deux mots occitans cloca : poule couveuse et clocir : glousser). Voir clouque, galinette, gorger, quéquét, poulet, poulétou.
gna gna
expr. Gnangnan. - Cette petite qui était si mignonne ! Elle est devenue un peu gna gna tu ne trouves pas ?
gnac
n.m. Aphérèse d'armagnac. - Un peu de gnac ! Rien de tel pour avoir du gnac !
gnac
n.m. 1. Morsure - Ce con de chien, il m’a foutu un gnac, j'ai cru qu'il m'emportait le poumpil !... (De l'OCC. nhac [pron. gnac] bruit de la mastication). ESP. ¡Ñac! Onomatopée utili-sée dans les BD pour traduire une morsure. 2. Avoir du gnac : être volontaire, déterminé, décidé à réussir ; être en pleine forme - Moi je me lève à six heures du matin, je monte jus-qu'à la Pipane, si je trouve trois cèpes, je les ramasse, à 8 heures je déjeune avec du jambon et du fromage, un peu de vin rouge... Après ça, con, j'ai du gnac pour toute la journée ! Avoir du gnac, pour une femme signifie aussi "avoir du chien".
gnaquer
v. Mordre. - Facteur, con, c’est dangereux comme métier ! Tu peux te faire gnaquer quarante fois par jour par un con de chien ! (De l'OCC. nhacar [pron. gnacà]).
gnasque
n.f. Morsure, "gnac" ; cicatrice. - Fais gaffe au chien en arrivant ! Il est pas commode ! Re-garde la gnasque que j'ai là, et ça fait plus d'un an qu'il m'a gnaqué. (De l'OCC. nhacar : mordre). Voir gnac, gnaquer.
gníco-gnáco, gnígo-gnágo
loc. - 1. - Lui, tout ce qu'il fait, c'est à la gníco-gnáco. … à la va vite, n'importe comment. 2. - Expression exprimant le bruit de la scie, la ressègue : conversation pénible ou en-nuyeuse. 3. Se dit aussi de personnes qui s'excitent mutuellement et se chamaillent - Ces deux, pires que chien et chat, toujours à gníco-gnáco ! Voir patín patan.
gnoc
adj. Mouillé. (Origine incertaine). Voir trempe.
gola, goula
n.m. Gorge du porc. On utilise principalement cette partie du cochon pour le pâté et le boudin, mais on peut la consommer également frite. Accompagné de frites, il constitue un des mets habituels du pèle-porc. (De l'OCC. golar [pron. goulà]). ITAL, CAT. gola : gorge. ESP. gula : gloutonnerie.
golgue
n.f. 1. Bille en terre des cours de récréation d'autrefois. Voir belbe, boulard, clote, hoyo, poque. 2. Bourses, testicules. (Origine incertaine. Amalgame possible de golça : gousse, et boga : bogue).
gommeux
adj. Vaniteux, snobinard. - Celui-là, quel gommeux ! (Origine incertaine).
gonfle
adj. 1. Enflé. - Il a trébuché en montant les escaliers ; après trois jours, il a encore le genou tout gonfle. (De l'OCC. enfle, et francisation du mot). ITAL. gonfio, CAT. inflat, ESP. inflado. 2. n.f. Ballon de rugby. Voir béchigue, bouigue, bourriche, pàoume.
gorger, engorger
v. Gaver. - Il faut que j’y aille ! C’est l’heure de gorger les canards ! Voir embuquer.
goudoufle
1. n.f. Ampoule. - Oh, lui au moins il risque pas de s'attraper des goudoufles aux mains, à rester assis sur son banc à l'ombre ! (De l'OCC. bodenfla : ampoule, vessie, bulle). 2. adj. Enflé. - Il faut que j'arrête de bouffer, moi, pasque là, je me sens un peu goudoufle ! (de l'OCC. bodenfle : enflé, bouffi ; orgueilleux).
goudoumar
n.m. Malotru, ours mal léché ; souillon. (De l'OCC. godomar).
goulamas
n.m. 1. - Goinfre, goulu. Quel goulamas çui-là ! Il mangerait un âne sans le peler ! Voir aganit. (De l’OCC. golamàs ou goulamard, eux-mêmes de gola : gueule). CAT. golafre. ESP. gula : gloutonnerie. 2. - Personne peu soigneuse, qui sabote un travail. - Tu peux plus faire confiance à personne maintenant, eh ! T'as que des goulamas qui te salopèjent le boulot par-tout ! (De l'OCC. golamàs : vaurien). Voir aganit, ganit, goulufard, tchapaïre.
goulufard
n. et adj. Morfale. (De l'OCC. gola : gueule). CAT. golafre. ITAL. gola : gourmandise, ESP. gula : gloutonnerie.Voir aganit, ganit, goulamas, tchapaïre.
goulut
n. et adj. Goulu-e, glouton-ne. (De l'OCC. golut, goluda). ITAL. gola : gourmandise, ESP. gula : gloutonnerie. Voir aganit, goulamas, goulufard, tchapaïre.
gountser
v. Huiler une poêle avant de faire cuire quelque chose. (De l'OCC. unchar, untar) ESP. et CAT. untar, ITAL. ungere.
gourgue
n.f. - Le dimanche on va promener à Garonne du côté des gourgues, il fait bon, il y a de l’ombre... Endroit où le fleuve fait des sortes de mares d’eau calme, mais parfois aussi pro-fonde. (De l'OCC. gorg et gorga [pron. gourg et goúrgo] : mare). Voir clot, igue, lavogne.
gourluper
V. Variante de ferluper, hurluper ou surluper. Voir ces mots.
gourmandises
n.f. Sucrerie, dessert sucré, friandise. Moi, pour finir un repas, il me faut toujours une petite gourmandise. (De l'OCC. gromand : gourmand). ESP. golosina.
gous
n.m. Chien, clébard. (employé péjorativement). – Mais où il est passé ce putain de gous ? (De l'OCC. gos). CAT. gos : chien. Voir pissegous
goût
expr. Avoir goût à : avoir un goût de. - Tu ne trouve pas que ce vin, il a goût à bouchon ? (De l'OCC. trobar a, sentir a). ESP. saber a corcho, même construction. Voir agaoumit, donner à, goûter sel, trouver à.
goutéjer
v. Tomber goutte à goutte, fuir en parlant d'un toit, dégoutter. - Je croyais avoir fait une affaire avec cette maison que je viens d'acheter... L'autre jour, il a plu quatre gouttes, j'avais le toit qui goutèjeait de partout. (De l'OCC. gotejar). CAT. gotejar, ESP. gotear, ITAL. gocciolare. Voir chagater, plaouvinéjer, pleuvoir.
goûter sel
expr. Goûter un mets avant de le servir afin de vérifier qu'il est bien salé. - Je m'en vais goûter sel avant d'amener ces champignons, parce que moi, je sale jamais assez... (De l'OCC. gostar de sal). Voir Voir agaoumit, donner à, goût à, trouver à.
goutte
n.f. Petite pluie. - Il a beaucoup plu cet après-midi ? - Oh, il a fait quatre gouttes, juste pour mouiller la poussière ! (De l'OCC. A fait quatre gotas [pron. goútos]).
gouttière
n.f. Fuite d’eau d’un toit. - Depuis le dernier orage, j’ai des gouttières partout à la maison ! NB. La gouttière en FR. est le chéneau. (De l'OCC. gotera [pron. goutèro]). CAT. & ESP. gotera : fuite d’eau, donc même sens qu'en parler méridional.
grabels
n.m. Pissenlits - Rien ne vaut une bonne salade de grabels, mais encore faut-il aller les ramasser ! (De l'OCC. gradèl ou grabèl).
gradaillé (pain)
Pain aillé. Voir chinché.
gragnote
1. n.f. Grenouille. 2. expr. - Manger la gragnote : faire faillite. (De l'OCC. granhòta).
gragnoutère
n.f. Bruit ; musique désagréable, rengaine, rappelant la monotonie du chant des gre-nouilles. - Arrête-moi cette gragnoutère, ça soûle ! (De granhòta : grenouille).
grahus
1. n.m. Souffreteux, malingre... - Regarde-moi ce chien, il veut rien avaler ! - Allez, mange, grahus ! (De l'OCC. grafús ou grahús : puant, grossier, charogne). Voir brèle, chisclét, ménut, piètre, peine, tras. 2. n.m. Ce qu'il reste du foin dans la grange après avoir enlevé celui-ci
graillou
n.m. Bon petit repas. (de l'argot FR. graille - nourriture - auquel s'est rajouté le suffixe diminutif occitan -ou).
grain d'aïl
n.m. 1. Gousse d'aïl. 2. Se dit d’un garçon aux cheveux plaqués, lissés ou gominés. 3. expr. Voir gigot.
graines
n.f. Petites graines : Graines de trèfle, luzerne (plantes fourragères). - Après avoir moisson-né le blé, l'orge, l'avoine... on moissonnait les petites graines. Allusion à leur petite taille par rapport aux céréales.
graisse d'endure
expr. - Je me suis tordu la cheville, eh bé le docteur il m'a dit que pour patienter, j'y passe de la graisse d'endure. C'est à dire qu'il faut prendre son mal en patience en attendant une probable amélioration. (De l'OCC. grais d'endura : m. à m. : graisse de patience, d'endurance.
grandas
adj. Adolescent, mais aussi trop grand pour son âge. - Atche-le ce grandas, là, qui va jouer avec les minots de la maternelle ! (Adj. grand suivi du suffixe augmantatif occitan -as). Grandoulinas se dit de quelqu'un qui est grand et qui n’a pas eu le temps de s’en rendre compte. Voir despindjolard, ficelle, galé.
grandét
adj. Grand, en parlant d’adolescents.- Mais c’est qu’il est déjà grandét ton dernier ! (Adj. grand suivi du suffixe diminutif occitan -ét). Voir despindjolard, ficelle, gafét, galé, grandas, jeune-fille.
graougner, graouiller
v. Pêcher à la main les poissons sous les pierres. (De l'OCC. graulhar : pêcher les grenouilles, lui-même de graulha : grenouille).
graoupigner
v. Griffer. - Et qu'est-ce que tu t'es fait à la figure ? - Oh ! C'est rien, je me suis fait graoupi-gner par le chat ! (De l'occ. graunhar, graupinhar : se gratter).
gratère
n.f. Avoir la gratère : avoir des démangeaisons et ne pas cesser de se gratter. - Depuis que j'ai touché ce chien, j'ai la gratère. Il avait des puces ou quoi ? (de l'OCC. gratela : gâle).
gratifous, graoutifous
n.m. Sensation d'irritation sur les muscles de la mâchoire que provoque un fruit insuffisam-ment mûr et quelque peu acide. -Elles me donnent le graoutifous ces prunes. Elles sont même pas mûres ! (De l'OCC. gratar : gratter ; démanger).
graton
n.m. Rillon. (De l'OCC. graton [pron. gratos]). Voir friton.
gratounade
n.f. Grande soirée organisée dans la salle des fêtes du village (Tarn, particulièrement) où l'on consomme un repas constituée de plats à base de canard uniquement - gratons, fritons (rillons), magrets, confits -. (De l'OCC. graton [pron. gratou]: rillon).
gratte
n.f. Roche sédimentaire constituée de petits graviers, dans la mine de Decazeville notam-ment. (De l'OCC. grata : grès dur et siliceux).
gratter
v. Démanger ; gratter. - Ça me gratte ! - Eh bé t'as qu'à te gratter si ça te gratte ! (De l'OCC. gratar). Voir gratusser.
gratusser
v.t. Gratter. (De l'OCC. gratussar : étriller). ITAL. grattare : gratter, grattugiare : râper.
grélade
n.f. Grillade de châtaignes, faite au moyen d'une poêle perforée mise sur la flamme. - Reste souper avé nous, vaï, qu'après on fera une grélade et on boira du vin nouveau ! (De l'OCC. grelada [pron. grelàdo]).
grésale
n.f Grand récipient de terre cuite verni, généralement jaune et vert, d'un diamètre avoisi-nant les soixante centimètres et la trentaine de profondeur, servant à recevoir les mor-ceaux d'oie, de canard ou de porc au moment de la découpe. Certaines grésales plus pe-tites sont conçues pour servir le cassoulet. MIDI TOULOUSAIN.
grillons
n.m. Voir gratons
grillous
n.m.pl. Inflorescence de choux avant épanouissement, se mangeant comme des brocolis, avec des œufs durs en vinaigrette. (De l'OCC. grilhons). Voir tanous.
grimace
n.f. Mauvais pli. - Tes pantalons ils font une grimace, là derrière. Soit ils sont mal repassés, soit ils sont mal faits. En tout cas, y a quicom que va pas ! (De l'OCC. far moninas : faire des grimaces - faire de mauvais plis).
grisette
n.f. (à Toulouse) compagne du flèou (voir ce mot). On dit aussi grisèto. (De l'OCC. griseta, sorte d'échassier). Voir carnaval, carnus, dame, jeune-fille, falsaïre, madonne, marâtre, mé-nagère, ménine, mounèque, nénette, patronne, pousouère, sansogne.
grougnàou, grougnou
n.m. Goujon (poisson). (De l'OCC. gronhau). Voir calicoba, canabère, fissou, gar-buste, montre, pescofi, piquée, puisette.
groule
n.f. 1. Vieille chaussure, grolle. - J’en ai marre de ces groulles qui me font mal aux pieds ! (De l'OCC. grola, grolla ou grolha [pron. groúlo, groúllo ou groúillo] : savate, vieille chaus-sure). 2. expr. - Porter les savates en groulles c'est les porter sans les lacer, en écrasant avec le talon la partie arrière.
groumandises
Voir gourmandises.
gueille
n.f. 1. Etoffe de bonde que l'on met pour éviter que le vin ne s'évapore du tonneau. 2. par extension : guenille, vieil habit - T'as pas autre chose à te mettre que ces gueilles ? (De l'OCC. guelha). Voir peillaròt, peille, tras. 3. Personne maladroite, manche. - Comment tu veux qu'ils passent en première division ? Il n'y a que des gueilles dans cette équipe ! (Origine incertaine, peut-être de l'OCC. guèlh : borgne, personne qui louche). Voir biais (avoir du), maoagit, mastoc, pastis, pégoumas, peintre, trastéjer.
guère
expr. Pas guère plus : Guère plus, beaucoup plus. - Arrête de chercher ! Tu as ramassé dix kilos de cèpes, tu n'en trouveras pas guère plus aujourd'hui, eh ! ... (De l'OCC. n'i a pas gaire : il y en a peu).
guetche
adj. et n. Louche ; strabique ; qui penche d'un côté plus que de l'autre. Se dit d'un objet de traviole.
gueuleps
n.m. Cri, hurlement ; forte engueulade. - Pousser un gueuleps : crier ; engueuler ; répriman-der quelqu'un ou un groupe de personnes très violemment. – Fais gaffe au nouveau chef, si t’arrives pas à l’heure, il pousse de ces gueuleps, con, il te fait peur ! (Du FR. gueuler). ARGOT LOCAL.
guigne
n.f. Griotte. En FR. la guigne est une petite cerise au goût très sucré au contraire de la guigne de chez nous qui est amère. (De l'OCC. guinda, guindol, griotte). CAT. & ESP. guinda.
guindoul
n.m. 1. Variété sauvage de cerise ; guigne. 2. Sexe du garçon. (Familier et non vulgaire, plutôt affectueux. De l'OCC. guindol : guigne). Voir piche, riuchiucchiu, sguègue.
guingassou, guingasson
n.m. Petit clou de tapissier. (Du GASC. guingachon pron [guingachou]).
guirbe
n.f. Corbeille ; panier oblong à anses ; panier de vendangeur ; panier de pêcheur. Je viens de ramasser les châtaignes, j'en ai une pleine guirbe. (De l'OCC. guirba). Voir banaste, carredjadou, garbuste, paillassou, panière.
H
ha !
interj. En avant ! Se dit pour faire avancer les bêtes (les vaches en particulier). - Allez ! ha !
habituer
expr. Habituer quelque chose : S’habituer à quelque chose. - Alors, tu les as habituées tes nouvelles lunettes ? : ... tu t'y es habitué ? (Calque OCC.).
haïssable
adj. Se dit d'un enfant quelque peu pénible. - Oh ! Qu'est ce que tu es haïssable, alors ! : Si tu continues comme ça, un jour ou l'autre il se pourrait bien qu'on finisse par te haïr… mais ce n'est pas sûr. (De l'OCC. aissa : souci, ou aissós : détestable, suivi du suffixe FR. -able). Voir caïner, carcinét, gâté-pourri.
ham !
onom. A l'adresse d'un enfant pour l'inviter à ouvrir la bouche pour manger. - Ham ! Elle est bonne la soupette, eh ? Quelle est bonne la soupette de mamie ! Haaaam! (Du GASC. hami : faim).
harencade
n.f. Hareng salé, hareng saur ; maigre, desséché comme un hareng saur. – A force de bouffer des lézards, j'ai le chat, on dirait une harencade ! (De L'OCC. arencada). CAT. arengada : sar-dine saumurée. ESP. arenque : hareng.
hart (hart négat)
adj. - Repu, gorgé, rassasié, assouvi ; soûl ; au figuré fatigué, excédé, qui n'en peut plus. - T'aurais dû venir au repas des chasseurs, on est sorti de là, con, harts négats ! (Du GASC. hart). CAT. afartar-se de manjar, même sens ; ESP. harto : repu, rassasié. Voir aganit, crébadis, escaner, gagner, harter, hartère, mascagner.
harter (se)
v. pron. Se rassasier, manger avec excès. Voir hartère. CAT. afartar-se de manjar, ESP. hartarse : même sens
hartère
n.f. 1. Rassasiement, dégoût. Voir afart, assadouler, bâfras, farnac, hart, rabaner, rebuter, reganter, reprocher. 2. Bombance, ivrognerie, cuite. - Quelle hartère ! : Quelle cuite ! Quelle ventrée ! Voir bandé, béouét, coufle, cufelle, empaffer, empéguer, fatigué, ganarre, joli, murge, pété, pinté, sadoul, tenir (en ~ une). 3. Ennui insupportable provoqué par un excès de travail, par une personne ennuyeuse. Voir assadouler, cagagne, empétégué, ergne, gníco-gnáco, mouscaille, peine. 4. expr. - Se gagner la hartère : gagner son pain. (Du GASC. hartera).
hasard (à tout)
expr. [pron. à toutazar] par influence de l'expr. OCC. a tot astre bon astre [pron. a toutàstre bounastre], alors qu'en FR. on devrait dire [à tou – azar].
heure
expr. 1. A bonne heure. - Tu t’es levé bien à bonne heure ce matin, macarel ! Tu es tombé du lit, ou quoi ? : ....de bonne heure… 2. n.f. - l’heure vieille : Ancienne heure, heure solaire, qui a été remplacée par "l’heure légale", en avance d’une heure sur celle-là. Cette expression s’employait surtout pendant l’Occupation où l’heure légale était l’heure allemande et dans les premières années de la mise en place de l’heure actuelle qui bouscu-lait quelque peu les habitudes de vie condionnées par l’heure solaire. - Nous, on dîne à midi, mais de l’heure vieille, eh, pas de l’heure nouvelle... (De l'OCC. l’ora vielha [pron. l'oúro biéillo]). 3. expr. - Rentrer à toutes les heures : rentrer très tard dans la nuit. Si tu sors ce soir, ne rentre pas encore à toutes les heures comme chaque fois ! Qu'on se fait du souci nous autres après ! (On dit aussi : rentrer toute la nuit).
hiorres
n.f. Andouille (Produit de charcuterie cuite, emballé en boyau, constitué principalement du tube digestif des animaux de boucherie, en particulier du porc).
hirbe
Voir guirbe.
hise
expr. Faire la hise : Faire bisquer, enrager quelqu'un en le rendant intentionnellement ja-loux. - Maman ! Il arrête pas de me faire la hise avec ses souliers neufs ! (Du GASC. hisa : défi).
hôtel
n.m. Restaurant. - Comme on va à Toulouse, on va pas s'embêter à emporter le casse-croûte, on ira manger à l'hôtel. : ... au restaurant.
houe
n.f. Outil de jardinage appelé bêche en français, de la forme d'une pelle tranchante sur la-quelle on appuie avec le pied, et servant à labourer la terre. NB. dans le MIDI TOULOUSAIN une bêche est une espèce de pioche à lame assez large et recourbée servant à sarcler. Cet outil s'appelle houe en FR.. NB. Dans l'Aude on ignore le nom de houe Voir andusac, bêche, bé-zouy, bigos, fessou, majunquer, paloun, pelle-bêche, pelleverser, sarclét, trinque.
houe
n.f. Buse, busard (Du GASC. hua).
hougner
v.t. Pousser du doigt pour faire entrer de force. (Probablement du GASC. honilh : entonnoir).
hourrer
v. Bousculer, battre, chahutter. - La prof, elle s'est fait salement hourrer. (Du GASC. : horrar : aboyer avec fureur, se disputer). Voir bastonner, batailler, castagner.
houy ! allez houy !
expr. Allez ouste ! A l'origine cri pour chasser les cochons.
hoyo
n.m. Jeu de billes consistant à envoyer la bille dans un creux ou trou. [Prononcer en accen-tuant sur le premier o]. Jouer au hoyo. (de l'ESP. hoyo, trou) : Voir belbe, boulard, boule, clote, golgue, paranclét, poque, trou, fossette.
huile cramée
n.f. Huile de vidange. - Qu'est-ce que t'en fais de l'huile cramée toi, Louis ? Oh bé moi je m'en sers pour allumer le feu dans le pré quand j'ai quelque branche à brûler par là, ça me coûte moins cher que le mazout ! - Ah ! T'as raison ! Et puis ça au moins c'est écologique, tê !
huile de souquette
n.f. Vin. (m. à m. huile de petite souche) - Tu veux une tisane Robert ? - Donne-moi de l'huile de souquette que ça me fera plus de bien que la tisane, vaï ! (De l'OCC. soqueta : petite souche). Voir gabel.
huit-cents
n.m. Un pain de 800 gr. - Certaines personnes continuent de demander un 800 à la boulange-rie et on leur sert un pain de 400 gr ! C'est de l'arnaque ? - Oh bé, non, c'est comme ça,… tout fout le camp, pauvre !
hum (à)
Voir fum (à).
hurguer
v. Fouiller dans un petit orifice afin d'en déloger quelque chose. Exemple avec une mini fourchette pour extraire un mollusque d'un coquillage. (En GASC. hurgar). ESP. hurgar, CAT. furgar, ITAL. frugare : fouiller.
hute (à)
expr. Partir à hute, GASCOGNE : prendre la fuite, déguerpir. (De l'OCC. a huta / a futa).